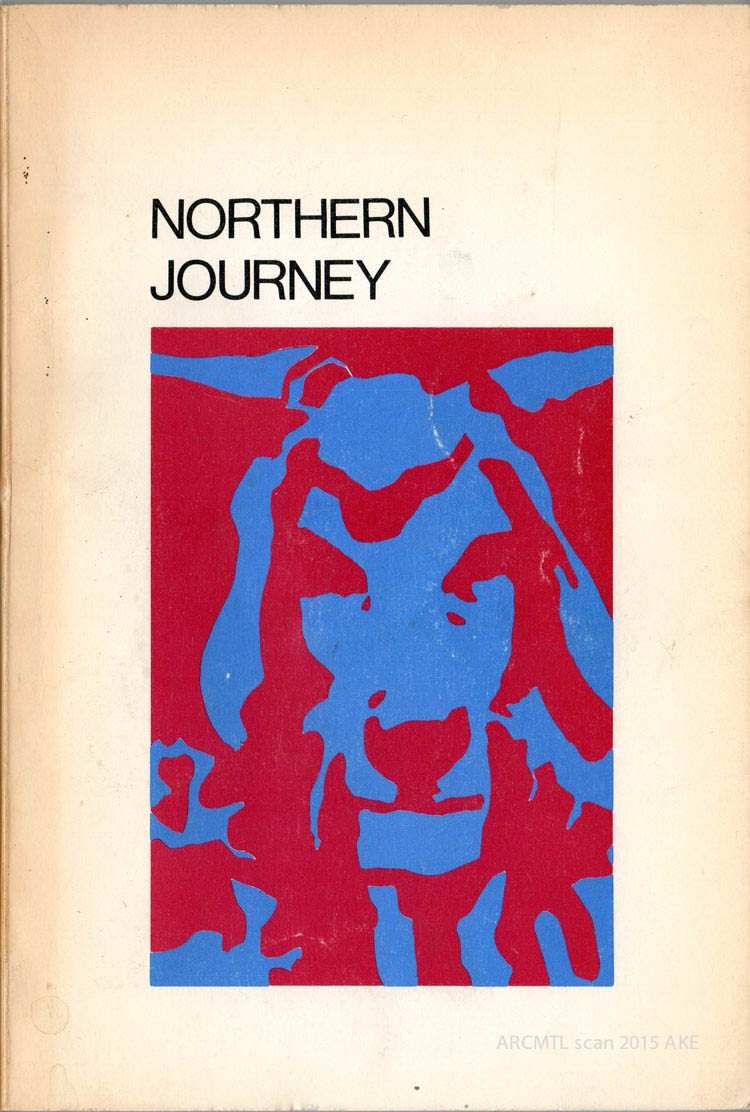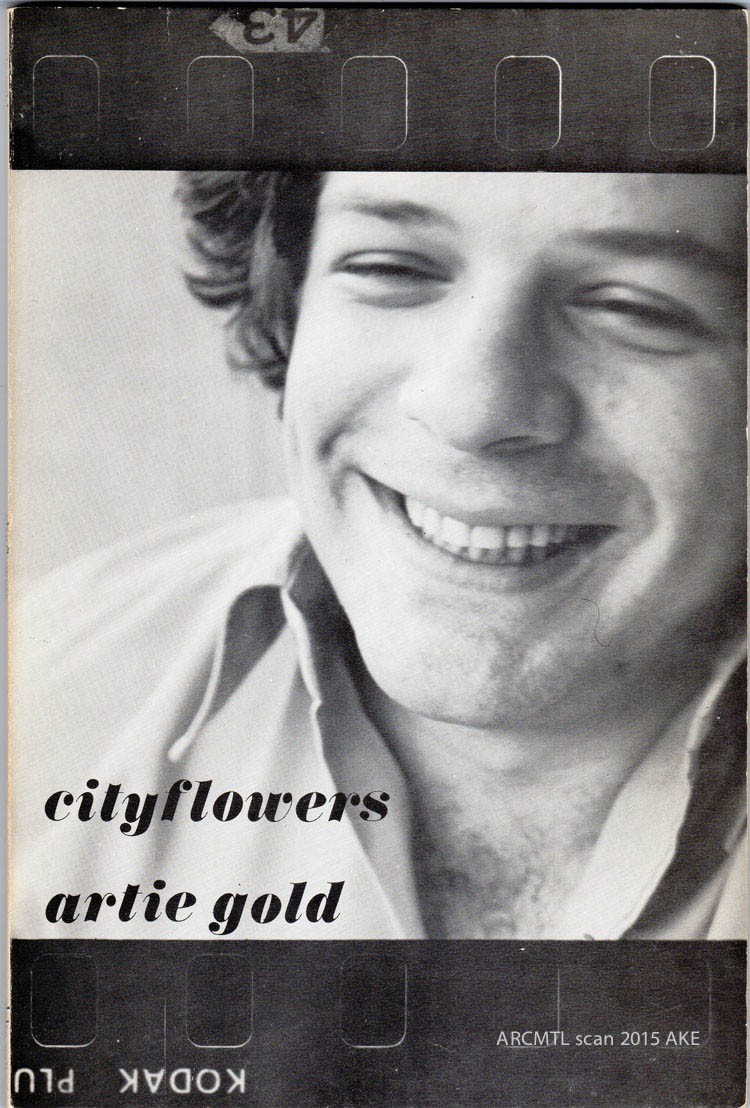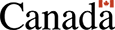Les débuts de la presse alternative à Montréal, années 1970
Lors de l’énorme salon des petits éditeurs Expozine, le dimanche 16 novembre 2014, Archive Montréal a tenu une table ronde au sujet du milieu de la presse indépendante des années 1970 à Montréal.
Les participants étaient les fondateurs de Véhicule Press, Simon Dardick et Nancy Marrelli, et le propriétaire de la librairie montréalaise The Word, Adrian King-Edwards. La discussion était modéré par Louis Rastelli.
À partir du milieu des années 1960, les quartiers centraux de Montréal ont commencé à développer un nouveau milieu culturel au sein duquel les artistes, les écrivains, les poètes et les musiciens pouvaient développer leurs pratiques artistiques innovatrices en collectivité. Ils ont développé des réseaux et des lieux de diffusions indépendants de ce qui était la norme de l’époque. Ces nouveaux espaces culturels ainsi que l’infrastructure de ces centres d’artistes autogérés, ces stations de radio communautaires, ces publications et presses indépendantes ont été incubateurs d’un mouvement « underground » de l’art dans plusieurs disciplines et qui, ne cesse de se perpétuer jusqu’à aujourd’hui.
Dans ce milieu embryonnaire de la contreculture, les Montréalais pouvaient assister à des lectures à la librairie The Word ou au centre d’artistes auto-géré Véhicule Art. La démocratisation des modes de production qui a marqué le début des années 70 – par exemple l’accès aux laboratoires de photographie, à la vidéo, aux presses collectives et divers centres d’artistes et centres communautaire – a également aidé à démocratiser et étendre la pratique artistique indépendante du « do it yourself », une tendance qui continue à s’accélérer encore de nos jours.
LÉGENDE
LR = Louis Rastelli
SD = Simon Dardick
NM = Nancy Marrelli
AKE = Adrian King-Edwards
LR : À quand remonte votre premier contact avec le milieu des petits éditeurs indépendants de Montréal ?
SD : Je suis un réfugié de Kingston, Ontario. Je suis venu ici dans les années 60, mais avant de venir ici, j’avais l’habitude de lire tous les magazines littéraires et les livres publiés à Montréal. J’avais l’habitude de lire les livres de Louis Dudek, Ray Souster, et les livres qu’ils publiaient sous les Éditions Contact. Donc, avant de venir ici, j’étais déjà préparé et puis Toronto ne m’attirait pas. Je ne veux pas dénigrer Toronto ; la ville n’avait tout simplement pas le même attrait littéraire que Montréal. Alors, quand je suis arrivé ici, tu flânes un peu, tu vois ? On traînait au Swiss Hut sur la rue Sherbrooke, non loin du club New Penelope. Au Swiss Hut, il y avait un mélange incroyable de gens : vous aviez des gens politisés, des felquistes, des syndicalistes, des littéraires, bref c’était un endroit génial. C’est à ce moment que j’ai commencé à avoir une idée du milieu.
AKE : Moi aussi je suis venu de l’Ontario et je suis allé à l’Université McGill. J’ai commencé à McGill en 67 et j’ai étudié la littérature anglaise. Et comme la plupart des étudiants en littérature anglaise, je voulais devenir poète, écrivain. J’ai suivi des cours en création littéraire et suite à l’obtention de mon diplôme, j’ai voyagé à travers l’Europe. Je suis revenu à l’âge de 21 ou 22 ans et j’ai estimé qu’il était temps d’écrire mes mémoires (rires). J’ai trouvé un minuscule appartement sur Lorne au sous-sol qui avait : une plaque chauffante dans le couloir, un matelas au sol, un bureau et une machine à écrire. J’ai pensé que j’avais tout ce dont j’avais besoin. L’appartement me coûtait 8 $ par semaine, donc les frais étaient vraiment bas. J’avais sagement renoncé à la poésie ; je me concentrais sur mes mémoires.
Ensuite, j’ai été distrait ; j’ai rencontré ma femme, nous sommes partis en Colombie-Britannique et nous avons passé l’été à vendre des livres à partir de notre fourgonnette Volkswagen. On ne pouvait pas faire la vente dans les zones municipales, mais on pouvait le faire dans des endroits comme des campements pour caravanes, pour miniers, bûcherons et autres. On a donc voyagé à travers la Colombie-Britannique en vendant des livres. C’était encore une ambition littéraire, mais un peu détournée.
Je suis revenu à Montréal et je voulais ouvrir une librairie. J’ai pensé que ce serait une chose vraiment amusante à faire et j’ai trouvé un 4 et demi sur la rue Milton pour 100 $ par mois, juste à côté de l’endroit où la boutique est aujourd’hui. Je n’ai pas vérifié récemment, mais je crois que ça l’a pas mal augmenté. Toutes les portes le long de la rue Milton étaient les mêmes et puisque nous avions tous deux étudié au département de langue anglaise et que nous voulions attiré les étudiants de McGill dans notre boutique de livres d’occasion, nous avons placé une image de George Bernard Shaw sur notre porte pour indiquer là où la librairie cool et underground se trouvait.
Les gens ont commencé à venir ; c’était très populaire et nous nous amusions beaucoup. Nous voulions vraiment connecter avec la communauté de la poésie. C’était en 72 ou 73, exactement quand les choses ont commencé. On était à la bonne place, au bon moment.
Un jour, Fraser Sutherland, alors rédacteur en chef du Northern Journey, est entré. Il avait été envoyé par M. George d’Argo – M. George est certainement l’un de mes mentors – et il voulait savoir si nous voulions avoir le Northern Journey à la boutique. À ce moment, j’ai pensé que nous avions réussi, que nous avions connecté avec la scène littéraire.
Nous sommes partis de là et nous avons organisé des lectures de poésie une fois toutes les deux semaines dans notre appartement, situé juste au-dessus de la librairie. Il y a avait tellement d’allées et venues qu’un après-midi, deux policiers sont venus faire une descente. Ils ont passé au peigne fin toutes les épices de la cuisine. L’un d’eux s’ennuyait tant qu’il s’est allongé sur le sol pour jouer avec nos chatons qui venaient de naître dans notre placard.
Quoi qu’il en soit, ils nous ont laissés tranquilles et ont continué leur chemin. Nous avons fait les lectures pendant environ un an et demi et à ce moment, la communauté littéraire était vraiment petite de sorte que vous pouviez connaître à peu près tout le monde de la communauté littéraire anglophone.
C’était un temps vraiment excitant, tout le monde débutait : Fred Louder, les presses Villeneuve qui commençait à faire des impressions fines, les lectures de Véhicule commençaient, nous y allions les dimanches après-midi à deux heures. J’ai même une affiche des lectures de Véhicule datant de 1975 pour vous donner une idée à quel point ils étaient actifs.
À ce stade, nous étions à la recherche d’un local. Nous étions déchirés entre vraiment chercher un local et attendre qu’il nous trouve. Un jour, je suis sorti pour promener le chien et le bâtiment où The Word Bookstore se trouve aujourd’hui, était une buanderie chinoise qui affichait : à louer.
C’était une évidence, la chose à faire. Nous sommes entrés et les choses étaient beaucoup plus faciles en 1975, le loyer était de 175 $ par mois et nous vendions des livres pour 25 cents. Les livres classés par ordre alphabétique étaient 35 ou 40 cents… c’était une époque plus facile.
Nous avons continué les lectures de poésie et nous avons aussi publié quelques titres. Nous avons publié avec Fred Louder et Brian McCarthy était aussi un poète alors. Brian vivait sur la rue Saint-Laurent juste au-dessus où sont les monuments aujourd’hui et alors qu’il quittait pour l’Europe, j’ai réussi à acheter sa collection de poésie ce qui était spectaculaire pour une librairie qui venait tout juste de commencer. J’ai réussi à obtenir sa machine Gestetner – beaucoup de choses dans les années 70 ont été produites sur une Gestetner – pour publier des trucs d’auteurs.
LR : Juste pour clarifier – un Gestetner est une presse cylindrique à manivelle que vous utiliseriez pour faire des copies de vos textes tapés à la machine à écrire.
NM : Véhicule a commencé en tant que galerie, la première galerie d’artistes autogérés à Montréal et la deuxième galerie d’artistes autogérés au Canada. Powerhouse était la galerie gérée par des femmes et elle était très, très importante en établissant un lieu où les femmes se sentaient en sécurité et à l’aise et où leur travail pouvait être montré.
SD : Oui, j’aimerais parler un peu de Véhicule et comment nous en sommes arrivés à ce nom. Comme Nancy l’a mentionné, c’était une galerie sur la rue Sainte-Catherine O. C’était vraiment un endroit étonnant qui avait déjà été un club – nous ne savions pas quel genre de club jusqu’à ce que nous publions un livre sur le jazz appelé, Swinging in Paradise. À l’arrière du livre, l’auteur avait indiqué l’endroit de tous les anciens clubs de jazz. Nous avons réalisé que durant toutes ces années, la galerie Véhicule avec la presse à l’arrière, nous avions travaillé dans ce club appelé le Café Montmartre. C’était un endroit très populaire dans les années 30, une sorte de Blind Pig des années 40, je suppose. Nous avions alors compris l’architecture du lieu avec ses très hauts plafonds et ses loges.
C’était un endroit idéal pour une galerie d’art autogérée. Nous arrivions le matin et nous ne savions jamais à quoi nous attendre. Il y avait toutes sortes de choses étranges et intéressantes à la galerie en tout le temps. C’était très diversifié : il y avait de la danse, des lectures de poésie sur une base régulière, c’était un endroit très stimulant. Les imprimantes se trouvaient à l’arrière. Nous imprimions un certain nombre de choses nous-mêmes, nos propres publications, mais nous avons fini par devenir l’imprimeur d’un grand nombre de petits éditeurs littéraires à Montréal. On était au courant de pas mal de choses à cause de ça parce que ça nous passait sous les yeux. En fait, en 1976, nous avions fait un petit catalogue et dans ce catalogue, j’avais remarqué que nous étions devenus les distributeurs d’environ sept ou huit petits éditeurs littéraires, comme le Cross Country Press, dirigé par Ken Norris, Jimmy Lee et une autre personne dont je ne me souviens plus. Nous avions imprimé des petits livres pour eux. En voici un très joli intitulé « Some of the cat’s poems » par Artie Gold, l’un de nos écrivains préférés.
NM : Je pense qu’il vaudrait la peine de mentionner qu’à l’époque, c’était vraiment, vraiment important pour les gens et pour la scène artistique en général, d’être très multidisciplinaire, cette idée de faire tomber les barrières de ce qui définissait un artiste visuel par rapport à un écrivain ou un artiste de la scène. Il y avait tout un mouvement qui cherchait à penser les arts de façon beaucoup plus large et c’est pourquoi la galerie avait des lectures de poésie ; c’était une tentative pour mélanger vraiment les choses. Je pense que ça l’a réussie, et ce, pour un bon moment. Il y avait de la danse et toutes sortes d’autres choses qui se passaient en même temps et dans les mêmes lieux. Il y avait beaucoup de pollinisation entre les arts.
SD : Vous savez, je n’avais pas vu ça venir. Il y avait une grande activité artistique à travers le pays, mais je pense que Montréal était très différente dans le sens que vous aviez une diversité, dès le départ. Et parce que nous étions imprimeurs, beaucoup de personnes issues de la communauté artistique ont fait affaire avec nous d’une façon ou d’une autre : affiches, catalogues…
LR : Vous produisiez des affiches pour les groupes de musique aussi ?
SD : Oui, et aussi pour les événements de galeries d’art. C’est ça qui soutenait nos opérations lorsque nous n’étions pas sur le chômage ou peu importe comment ça s’appelait. Il était difficile de faire de l’argent, mais on se débrouillait. Nous avions aussi d’excellentes relations avec nos collègues et avec les autres imprimeurs en ville avec qui nous faisions une sorte d’impression alternative. L’une d’elles était Presse Solidaire, l’imprimeur marxiste-léniniste. Ils avaient de plus grandes presses que nous et quand nous ne pouvions pas exécuter un certain travail, nous utilisait leur presse.
Ce qui est fascinant avec eux, c’est qu’ils craignaient que leur imprimerie soit attaquée par la GRC alors que les préparatifs pour les Jeux olympiques de 1976 étaient en cours. Ils ont décidé de fermer leurs portes. Ils ne voulaient pas que leur matériel soit endommagé de quelconque façon et – peut-être c’était de la paranoïa – ils ont fermé et ont envoyé tous leurs clients chez nous trois semaines avant le coup d’envoi des Jeux. C’était merveilleusement bizarre parce que nous utilisions beaucoup d’encre rouge ! C’était une époque très intéressante alors que nous étions la presse non sectaire de la ville.
LR : Vous imprimiez des publications anglophones pour la plupart ou imprimiez-vous des publications en français aussi ?
SD : Eh bien, nous avons travaillé avec Lucien Francoeur. Nous avions fait une traduction de ses écrits et lorsqu’on lui avait montré, il a dit : « Oh mon Dieu ! C’est tellement américain ». Il était très heureux de l’allure américaine du livre – nous, on ne voyait pas trop en quoi c’était américain, mais peu importe. J’ai avec moi un … c’est n’est pas celui que nous avions imprimé, mais j’ai pensé que c’était un livre de Lucien Francoeur vraiment bien fait, publié par Les Herbes Rouges, appelé Snack-bar. Il est vraiment intéressant quand on regarde l’arrière – c’était les années 70 – c’est en quelque sorte autant français qu’anglais. C’était vraiment expérimental.
LR : Le sentiment qu’on a, avec ce que l’on a parlé jusqu’à présent, mais aussi en puisant dans mon propre vécu de vétéran du milieu des petits éditeurs indépendants du début des années 80, est que les deux solitudes sont un peu moins présentes parce que je ne pense pas qu’elles pouvaient se permettre de l’être étant donné qu’elles étaient si petites. Je me demande dans quelle mesure c’était le cas. Il pouvait y avoir quelques cafés, lieux de rencontre et des lectures de poésie dans les deux langues… Quelle était la situation, à l’époque ? Est-ce que les deux communautés se mélangeaient beaucoup ?
SD : Vous savez, c’est drôle parce que d’une certaine manière – ou dû moins, du point de vue de nous, de notre imprimerie – c’est plus mélangé aujourd’hui que ce l’était alors. Non pas que nous avons plus d’argent maintenant, ni que nous pouvons échanger les droits d’impression avec nos collègues francophones, mais il me semble que nous étions très absorbés par nos petites scènes respectives. Ça se croisait parfois, mais vraiment pas beaucoup. En tant que coopérative d’imprimerie, nous avons eu ce genre d’échange; nous nous rendions des faveurs les uns, les autres, mais de façon générale, il n’y en avait pas beaucoup. Quelle était votre expérience Adrian ?
AKE : C’était une très petite communauté, ce qui avait son avantage parce que vous connaissiez tout le monde. Si vous alliez aux lectures de Véhicule Press, vous pouviez connaître tous les poètes anglophones de Montréal. Ce qui est extraordinaire, c’est que toute cette floraison s’est passée en même temps, au début des années 70. J’ai apporté un magazine réalisé par Raymond Gordy, daté de décembre 1972, des poèmes agrafés, appelés Booster et Blaster. L’idée était que si vous étiez un poète anglophone montréalais, vous pouviez facilement être publié dans le magazine, mais à l’arrière de celui-ci, vous aviez curieusement des critiques. Vous aviez donc des poètes qui critiquaient le travail d’autres poètes. Il y a aussi une déclaration au tout début qui explique ce qu’ils voulaient faire, comme s’ils pressentaient, en 1972, soit pré-Véhicule Press et leurs lectures, qu’une telle floraison allait advenir. Je vais vous lire la déclaration qui reflète également le fait que la communauté anglophone se sentait comme une minorité distincte.
« Le Booster et Blaster publie seulement des poètes montréalais, une communauté très distincte. Il y a une raison pour cela. Nous sommes des anglophones, physiquement circonscrits dans une communauté francophone beaucoup plus grande, mais une communauté qui partage paradoxalement une façon de penser majoritairement anglophone. C’est politiquement difficile et ça devrait créer une poésie avec un contenu et un engagement considérable. En un sens, ceci n’est qu’un début. Trop de poésie est aussi une critique du reste du Canada anglais. Trop de poésie au Canada anglais est une poésie d’expériences, un enregistrement sans réflexion. Ici, au Québec, cette approche est inacceptable. Nous allons être spéciaux. Ici, la grande poésie anglophone sera écrite ; non seulement elle sera confessionnelle, mais historique, traitant de la survie des réalités locales distinctes du Québec ».
Je pense que c’est quelque chose d’un peu dépassé, mais en définitive, les poètes anglophones se sentaient comme une communauté, qu’ils allaient laisser leur marque et que ça allait être bon.
NM : Je pense qu’en général, les gens étaient conscients de l’existence des uns et des autres, mais ce n’était pas… il y avait une certaine interaction, mais je ne pense pas qu’il y avait beaucoup de projets communs. Il y avait certainement des traductions et à l’époque, nous avions tendance à faire des face-à-face, donc où vous publiez le texte en anglais d’un côté et celui en français de l’autre, chose qui n’est plus populaire du tout. En fait, tout type de publication bilingue est désormais considéré comme la mort assurée.
LR : Nous en voyons encore un peu à Expozine, mais très peu.
NM : C’est considéré comme un cauchemar au point de vue marketing parce qu’aucune des communautés n’apprécie. Je ne comprends pas pourquoi, mais…
LR : Ce que les futés font aujourd’hui, ce sont des bandes dessinées et fanzines sans mots, mais ça ne peut s’appliquer qu’aux trucs plus abstraits.
NM : Je pense qu’il y avait une grande sensibilisation entre les communautés francophones et anglophones, mais je pense que les gens étaient très accaparés par ce qu’ils faisaient et avaient tendance à fréquenter leur propre communauté.
SD : Il y a une imprimerie que j’aimerais mentionner : Ginette Nault. Elle et son mari étaient des gens incroyablement uniques de qui j’ai amené un livre, je pense que c’est un livre spectaculaire et c’est… In Guildenstern County par Peter Van Toorn, qui était un poète phénoménal. C’est Ginette Nault qui l’a imprimé en couleur et ils ont fait un travail charmant. Ils ont beaucoup travaillé avec les poètes anglophones.
LR : Bon nombre de nos exposants réguliers ont imprimé chez elle jusqu’à il y a environ… Je crois qu’elle a fermé boutique il y a deux ans environ.
SD : Est-ce vrai ? C’est incroyable. Oui, elle doit être d’un certain âge.
LR : Il y a une chose que je voulais mentionner parce que nous voyons un continuum qui débute, dans un sens, dans les années 60 et que nous voyions aujourd’hui prendre forme dans quelque chose comme Expozine qui a ses racines dans ces sortes de pratiques comme les coopérations d’imprimerie et de travailler ensemble pour des événements, la promotion, les affiches ou pour partager les espaces de travail.
SD : Tu as raison parce que je pense que la diversité dont nous parlions quand on décrivait la scène des années 70 qui gravitait autour de la galerie d’art Véhicule, je pense qu’Expozine est tout à fait unique. Quelqu’un est venu à notre kiosque aujourd’hui disant qu’il était allé à une foire du genre à Toronto et qu’il y avait une ambiance complètement différente. Je ne pense pas que vous avez le même genre de tensions culturelles passionnantes et les réalisations que vous avez ici.
LR : Je suis curieux de savoir les endroits où ces publications se vendaient ? Était-ce un peu comme ce que quelqu’un aurait à faire aujourd’hui pour publier leur propre fanzine, mis à part de le publier sur le web, chose qui n’existait pas alors, donc d’aller se présenter en personne dans un circuit de petits magasins qui acceptaient de vendre en consigne ? Est-ce que les kiosques à journaux en tenaient ?
AK : Il y avait trois endroits principaux : The Word, bien sûr, le Double Hook, Judy Mapple’s – elle est une grande partisane des poètes locaux – et un autre grand partisan de poètes locaux était M. George au Argo qui était là bien avant moi.
SD : Et Mansfield Book Mart. Vous pouviez les trouver sur l’étagère du bas en train de ramasser la poussière.
AK : Oui, donc quatre endroits.
NM : Mais à part ça, les publications des femmes étaient très nombreuses. Il y avait de petites publications de toutes sortes qui traitaient des questions relatives aux femmes ; certaines d’entre elles étaient littéraires, d’autres pas, en fait, beaucoup ne l’étaient pas et j’avais une collection énorme. J’ai gardé beaucoup de ces publications. Et vous les trouviez un peu partout. Vous alliez à un événement et l’on y vendait des publications. Les gens vendaient leur propre truc. On les ramassait. Vous alliez à New York et vous pouviez revenir avec 50 exemplaires de quelque chose ou vous alliez à une manifestation à Boston et vous trouviez des choses. C’était juste partout, partout autour de vous. À tous les événements, on rencontrait des gens qu’on connaissait, c’était très underground. Les publications de femmes n’étaient pas vendues en librairies, que je sache. Il y avait le Centre de femmes qui s’est ouvert sur la rue Saint-Laurent. Il était situé au-dessus de la où la Charcuterie Hongroise est située aujourd’hui. C’était le premier Centre de femmes et l’on y vendait certainement des publications. Je ne peux pas me rappeler où je me les procurais. Nous les avions, c’est tout.
LR : Y avait-il beaucoup de rassemblements particuliers, de foires de petits éditeurs ou était-ce davantage organisé autour des lectures où l’on pouvait trouver une petite table avec quelques titres ? Y avait-il des foires organisées pour petits éditeurs indépendants dans les années 70 ?
SD : Non, pas dans les années 70.
NM : Mais il y avait des événements et l’on vendait aux événements. Il y a donc des gens qui se sont réunis autour de causes communes et à ces événements, ils vendaient les publications dont certaines étaient très petites.
LR : On ne voudrait pas s’éterniser, mais nous avons encore 10 minutes environ, je voudrais voir s’il y avait des questions ?
Will Straw : Ça serait plus pertinent pour Simon et Nancy. Ces jours-ci, on ne pourrait rien faire sans une subvention. Y avait-il quelque chose dans la façon dont l’argent du gouvernement circulait à l’époque ?
SD : Comme je l’ai mentionné plus tôt, quels que soient les acronymes qui fournissaient une sorte de financement, de quelconques manières, nous l’avons utilisé. Nous louions l’e local à un coût modeste puisque nous avions tout cet équipement. Nous avions tout de même besoin de nous nourrir, alors on était sur l’assurance-chômage quand il fallait. Il y avait un projet appelé le CYC, la Compagnie des jeunes Canadiens, qui encore à ce jour, je n’en comprends pas grand-chose, sauf que vous pouviez obtenir une sorte de « subvention », question de nous garder en vie. Il y avait LIP, un programme de subventions pour des projets d’initiative locale. Nous allions de subvention en subvention, puis sur le chômage et l’on arrondissait avec les contrats d’impression.
Will Straw : C’est intéressant parce que nous savons qu’avant qu’il reçoive du financement pour les arts, le mouvement des centres d’artistes autogérés obtenait ces subventions pour « jeunes » ainsi que de l’assurance-chômage pour se développer. C’est un côté inexploré de son histoire.
NM : C’est sûr. Tous ces programmes étaient des subventions majeures. Beaucoup de gens travaillaient également dans les bibliothèques de l’Université Concordia – la bibliothèque Sir George était pleine d’écrivains, d’artistes et de danseurs.
SD : Et d’insoumis ( draft dodgers ).
NM : Beaucoup de gens qui étaient impliqués dans les mouvements politiques de toutes sortes, et bien sûr, les gens ont pris les emplois qui leur permettaient de se nourrir pour qu’ils puissent faire les autres choses qui les intéressaient. J’ai abouti dans les bibliothèques de Concordia, puis dans les archives – il faut manger.
SD : Puis à nouveau, au milieu des années 70, l’économie allait assez bien et les gens n’ont pas hésité à quitter leur emploi et en disant : « Je vais faire du stop à Vancouver » ou peu importe. Comme l’a mentionné Nancy, à Sir George Williams (aujourd’hui Concordia) vous aviez un grand nombre d’insoumis et les gens qui étaient venus à Montréal pour trouver un emploi, c’était un bon emploi.
Je dois aussi dire qu’il y avait une prolifération de presses littéraires au Canada dans les années 70. Si vous pensez à nous ou à Turnstone Press à Winnipeg …
NM : Mais ce n’était pas seulement littéraire – c’était la danse, le théâtre, la musique et c’était partout. Je ne pourrais pas trop insister sur le désir, la volonté de vraiment intégrer les arts dans un niveau beaucoup plus fondamental que nous l’avions vu auparavant – et que nous avons vu depuis.
LR : Est-ce que l’un de vous pourrait dire que la génération des baby-boomers qui a créé une des plus grandes générations de jeunes –
NM : De jeunes gens instruits.
LR : De jeunes gens instruits ont quelque chose à voir avec cette floraison, ce désir d’être aussi impliqué ?
SD : Oui, et pour des raisons évidentes, le mot, le mot écrit, était très important à cause de ça. Les imprimeurs canadiens qui ont été des pionniers de presses modernes comme Coach House Press, Talonbooks sur la côte ouest ont commencé dans les années 60, mais il y avait très peu de presses. C’est vraiment dans les années 70 que l’on trouvait des maisons d’édition d’un océan à l’autre.
LR : Et pour le coût de la vie, vous avez mentionné un peu plus tôt le fait que vous étiez en mesure d’obtenir un appartement pour 100 $ par mois, un local commercial pour 175 $ et ainsi de suite. Bien entendu, les salaires étaient bas, mais de ce que j’ai compris, c’était beaucoup plus facile de s’en sortir sans avoir à passer la moitié de votre revenu dans votre loyer. Vous avez peut-être même été en mesure de payer votre loyer après seulement quelques jours de travail, qui sait.
SD : Par contre, je pense que chaque génération dit ça (rires). Nous payions 42 $ pour notre appartement sur la rue Clark, puis j’ai loué le premier étage, là où j’avais mon atelier de peinture. Donc au total, c’était 82 $ par mois…
LR : Mais ça l’a permis aux gens de créer tout se qu’ils créaient et de s’impliquer comme ils le faisaient…
AKE : En fait, nous n’étions pas terriblement préoccupés par les finances. Maintenant, était-ce une fonction d’être jeune… Mais nous avions l’habitude de tout fermer en août pour aller dans le Vermont (rires).
SD : C’était un style de vie (rires).
AKE : Oui, en effet.
Q : Était-ce prohibitif techniquement et financièrement de publier des romans, les gros livres, à la fin des années 60 ou était-ce possible ?
SD : Peut-être parce que j’étais un poète manqué moi-même, mais nous étions surtout intéressés par la poésie et parce qu’on venait d’une galerie d’art, nous avons fait beaucoup de livres d’artistes aussi. Mais nous n’étions pas intéressés par les romans. Est-ce que les gens écrivaient des romans ? Je suppose que oui, je ne suis tout simplement pas au courant.
NM : Je suppose qu’ils allaient aux grandes maisons d’édition. C’était le même problème avec les galeries d’art – les galeries d’art grand public montaient des expositions traditionnelles et c’est pourquoi les galeries indépendantes se sont formées. Il aurait été très coûteux pour une petite maison d’édition de produire une telle chose et les chances de réussite auraient été tellement basses que les dépenses auraient pu faire sauter toute l’opération.
SD : Nous avons imprimé notre premier gros livre en 1980 seulement et nous avons commencé en 1973. On commençait alors à faire de la critique littéraire. Je crois qu’on voyait peut-être la poésie comme pas très populaire et c’est une des raisons pour laquelle c’était attirant pour nous. Nous n’avons, bien sûr, pas fait d’argent.
ND : Ce n’était jamais à propos de l’argent.
LR : Je suis persuadé que la poésie n’est pas plus populaire aujourd’hui…
SD : Non, elle ne l’est pas.