À la porte du New Penelope Café avec Allan Youster
LR: Qu’en était-il des musiciens ? Y avait-il un sous-sol, une salle arrière ou une loge ?
AY: Non. Lorsqu’on rentrait, il y avait un vestibule, il y avait une billetterie, une autre salle et puis il y avait un grand vestiaire, et c’était tout. Alors, ils auraient pû y avoir fumé, mais si vous étiez dehors, il y avait un terrain de stationnement à l’arrière de la place. Alors si vous étiez là, vous pouviez sortir de la porte arrière ou aller aux toilettes pour fumer mais, les gens qui étaient en dedans devaient sortir et faire le tour. Le pot, ce n’était pas pareil qu’aujourd’hui. C’était si nouveau, je veux dire c’était assez laxiste, mais à l’époque c’était étrange !

A frame from an undeveloped negative taken at the then-new New Penelope on Sherbrooke St. in 1967 by Jeremy Taylor, from the collection of Francois Dallegret, digitized by ARCMTL in 2015.
AY: Lorsque vous passiez à travers le ghetto McGill, ou que vous passiez à travers tout ce secteur, c’était plus orienté vers les étudiants que ce ne l’est aujourd’hui. Je veux dire, c’était juste des fêtes avec des portes ouvertes. Personne ne verrouillait ses portes. Quand j’étais plus vieux et que je suis allé à l’école secondaire, je n’avais jamais de clé pour la maison, nous ne barrions simplement pas les portes. Nous avons habité à St-Laurent jusqu’à ce que je parte, en 1975, et nous ne verrouillions rien à clé.
C’était différent à l’époque. C’était assez ouvert, mais Gary ne permettait pas de pot à l’intérieur du Penelope, ça aurait posé des problèmes. Je suis certain qu’ils ont essayé d’avoir un permis d’alcool, mais qu’ils se sont simplement fait dire « NON ».
LR: Vous rappelez-vous s’il y avait beaucoup de francophones qui allaient à des concerts ou qui jouaient au New Penelope ?
Robert Charlebois a joué au New Penelope [accompagné du QUATUOR DU JAZZ LIBRE DU QUÉBEC], ils ont joué deux dimanches de suite. Les groupes jouaient du mardi à samedi, nous avions un groupe local le dimanche et le lundi nous étions fermés. Ça c’était notre horaire. Le dimanche était un soir plus calme, seulement deux parties. Sonny Greenwich a joué là quelques dimanches, mais en tout cas, pour revenir à Louise Forestier et Robert Charlebois…
LR: Étaient-ils les seuls francophones à jouer au New Penelope ?
AY: Ouais !
LR: Est-ce qu’il y avait beaucoup de monde qui venait voir Charlebois ?
AY: Oh ouais ! Mais, disons-le comme ça, ce n’était pas les habitués qui venaient – ils amenaient leur propre public. Je les ai vus et je ne le croyais pas ! Ils étaient incroyables ! Puis je les ai vu le dimanche suivant, et j’ai tout compris – l’affaire du chansonnier – tout était pareil, chaque geste de la main, chaque émotion, chaque geste du visage était le même ! Je ne l’avais jamais réalisé avant, ça. L’une des choses spéciales au Penelope était qu’on pouvait voir un groupe jouer là pendant une semaine complète… Mais le groupe de Muddy Waters ne jouait jamais la même chanson de la même façon… Ils jouaient la même chanson, mais les solos de guitare étaient différents…
LR: Alors lorsqu’il jouait cinq soirs d’affilés, trois sets en un soir…
AY: Il faisait mardi-mercredi-jeudi deux sets, vendredi-samedi trois sets, jouait beaucoup des mêmes chansons, mais les solos de guitare n’étaient pas les mêmes. Ils ne jouaient pas les mêmes choses… je veux dire, c’était les mêmes chansons, mais ce n’était jamais pareil ! C’était la beauté de la chose. Avec les chansonniers, chaque geste de la main était étudié, répété. Il y avait des groupes qui étaient des « numéros », comme les Times Square Two, ils constituaient un numéro de folk et avaient un spectacle, des sketchs, mais c’était toujours pareil et vous saviez d’avance ce qui était à venir.
 LR: Est-ce que vous alliez au Esquire Show Bar pour voir des concerts ?
LR: Est-ce que vous alliez au Esquire Show Bar pour voir des concerts ?AY: J’y allais plus quand Gary y allait. C’est devenu un peu étrange vers la fin. C’était le genre d’endroit où il fallait acheter une boisson pour chaque set, c’était un peu luxueux… c’était plus cher et pas si décontracté, mais le Penelope était assez spécial, définitivement une boîte à chansons.
LR: C’est difficile à imaginer aujourd’hui qu’il n’existait qu’une seule boîte du genre…
AY: Si le Penelope avait eu un permis d’alcool, ça existerait peut-être encore aujourd’hui. C’est l’une des raisons pour lesquelles je préfère personnellement traîner au Barfly, ce n’est pas pour la bière, c’est pour la musique et les gens… ça va au-delà du lieu même !
LR : Dans ce temps-là, où alliez-vous pour acheter un album dans St-Laurent ?
AY : Jay Boivin était dans The Sinners, et ses parents tenaient un magasin de disques sur Décarie proche du Collège, juste en face du Boucher de France près du parc Beaudet. Le magasin s’appelait Boivin’s et vendait des instruments de musique et des disques.
LR : Il y avait un magasin de musique pas loin de là où j’achetais mes cordes de guitare…
AY : B-Sharp. Ils vendaient des instruments puis plus tard ils ont fait de la location, les groupes venaient y emprunter de l’équipement. Bob Panetta travaillait là, je crois qu’il était dans The Oven, un groupe rock de St-Laurent. Il a une histoire sur Zappa – Il a prêté son propre ampli à Zappa, parce que Zappa est descendu à B-Sharp et il n’y avait plus rien – tout était loué !
Au début, c’était sur Décarie et puis ça a déménagé un peu plus loin sur la rue MacDonald, il y avait un sous-sol et c’était un magasin beaucoup plus grand. En fait c’est là que j’ai rencontré mon épouse Gail—Bob Panetta me l’avait présentée. Je suis allé à B-Sharp un jour pour voir Bob et il a pris sa pause, et a dit laisse-moi te présenter…
LR: Connaissiez-vous le propriétaire, Jack Tepley ?

AY: Bien sûr ! Voici [Il va dans l’autre pièce pour montrer l’affiche promotionnelle de l’album de Abbey Road], ceci vient de Tepley. Lorsque c’est sorti, c’est resté dans son magasin pendant des années. Lorsqu’on s’est mariés, il a dit : « Je vais vous donner un cadeau. Qu’est-ce que vous aimeriez avoir ? Ne demandez pas grand’ chose ! » et j’ai dit : « Pourquoi pas cette affiche ? Lorsque tu auras fini avec » et il a dit : « Bien sûr, bien sûr, un cadeau de mariage ! » Plus tard, il a lâché la musique et s’est orienté plutôt vers la location. Savez-vous comment ça marchait là-bas ? Quand vous y alliez, il vous prenait en photo. Il avait des photos de tous les gens qui louaient son équipement. Les groupes de musique entraient pour louer un équipement… « Je ne l’ai jamais loué! » et il disait : « Vous êtes debout avec et j’ai pris une photo. » Parce qu’il s’était fait avoir tellement de fois…
LR: Ça c’est une superbe petite anecdote au sujet de Jack Tepley. Il avait certainement toute une collection d’albums aussi…
AY: Je ne sais pas s’il collectionnait. C’était un homme d’affaires. Il s’est retiré de tout ça, et est simplement dirigé vers la location. Il louait des systèmes de son, des scènes—c’était gros—pour un certain temps.
LR: Nous n’avons pas parlé d’Expo… J’ai entendu dire qu’Expo 67 a presque tué le centre-ville parce que les gens se battaient pour aller y jouer…
AY: Oh ouais ! Le New Penelope a ouvert après qu’Expo eut fermé. Si vous aviez votre passeport, vous rentriez gratuitement à Expo 67 tous les jours, mais s’il y avait un concert, vous deviez payer. Il y avait plusieurs groupes qui jouaient à Expo tout le temps, des groupes locaux… des amis à nous de St-Laurent… Sheffield Steel jouait à Expo, ils ont embauché toutes sortes de groupes.
Au New Penelop, en été, on ne parlait que de The Sidetrack—c’était le house band tout l’été. Ils étaient dans le blues et ils commençaient à toucher au jazz. Ils faisaient du blues strict avec des solos prolongés et ils jouaient du piano… ils avaient de très bons solistes et c’était à la mode à l’époque, un peu comme sur le disque East-West de Paul Butterfield’s Blues Band. C’était ce qui se passait dans les concerts à ce moment, les groupes entraient dans le rythme et improvisaient. Sidetrack est allé à New York et ils leur ont fait un album, le pire album au monde…
LR: Ouais, le son est mauvais, c’est vraiment pas flatteur…
AY: Il n’y a pas de blues, le chant n’est pas bon, il n’y a pas d’harmonica… ça c’est après qu’ils aient été à New York, alors j’imagine qu’ils ont essayé de changer leur son.
LR: C’est exact. Vous aviez en fait mentionné comment ils avaient remplacé Butterfield au Café à Gogo.
AY: Je veux dire, ça, ça témoigne de combien ils étaient bons, et c’est pour cela que cet album fût tellement décevant. En tout cas, pour revenir au vieux Penelope : j’allais là-bas et j’y traînais tellement que je connaissais tout le monde, alors lorsque le New Penelope a ouvert et que j’étais partant pour travailler pour 6 $ la semaine… autant que j’aimais Gary, il n’a jamais été connu comme étant un philanthropiste.
LR: Alors il était co-propriétaire ?
AY: Il était le nom associé à la place. Il y avait trois propriétaires : Nat Katz, Bob McKenzie et Gary Eisenkraft, mais Gary était le gérant, il était le nom et il était la connexion, il connaissait Albert Grossman à New York et c’est comme ça qu’il a réussi à faire venir Butterfield, the Fugs…
Alors ils étaient partenaires. Je pense que Nat était un ingénieur et il avait un emploi mais je ne le voyais pas très souvent, je ne lui ai jamais beaucoup parlé et il ne s’impliquait pas beaucoup dans le lieu, il venait de temps à autre. Gary était le plus présent, mais Bob était là aussi et il présentait les groupes quand Gary n’était pas dans les parages, et il était là assez souvent. Il vivait proche de là.
LR: De ce qu’on m’a dit, il semblait que Gary s’occupait d’à peu près tout : réserver le lieu, choisir les groupes, écrire les contrats et je présume qu’il devait acheter le matériel, embaucher et renvoyer le personnel…
AY: Il y avait des serveuses, toujours deux ou trois. Les soirs les plus occupés, il y en avait trois. Tu ne fais de l’argent qu’en vendant du café et du chocolat chaud, de la limonade, et du jus d’orange et tu as 200-300 personnes à l’intérieur et ils ont soif, et c’est là que tu fais ton argent. Les entrées vont payer le groupe—tu dois payer le loyer et te payer toi-même !
LR: Mais je suis certain qu’il était capable de prendre une commission; mettons pour The Fugs, à deux concerts par soir, cinq soirs d’affilée, 2.50 $ le ticket… Disons qu’il y avait 200 personnes à chaque concert…
AY: Oh ! Je dirais qu’il y avait plus de 200 personnes par concert.

An original copy of the cardstock Fugs poster that hung at the New Penelope before their 1967 show. Allan Youster put it up on his wall just after the show, where it remained until ARCMTL briefly removed it for digitization in 2015.
AY: Disons-le comme ça, ça c’était la version officielle. Ils étaient comme The Beastie Boys—ils ne jouaient pas—il y avait un groupe derrière eux. Ils étaient à l’avant, en train de faire leur numéro, c’était les chanteurs. Ils avaient une basse-guitare-batterie, un super groupe de rock—on parle de putain de musiciens newyorkais ! Ceci est venu après les Virgin Fugs [LP], Tenderness Junction était l’album de l’époque, alors c’était le groupe [qui jouait].
LR: Quelqu’un nous a dit qu’ils se rappellaient en fait comment le concert avait commencé—je pense que c’était Ed Sanders qui était sorti et avait dit « Que faire en cas d’attaque à la bombe atomique », qui était l’une de leurs compositions… ça finit par « mets ta tête entre les jambes parce que t’es fini ! »
AY: J’ai un accessoire datant de cette époque. Ça dit simplement : « Sentier Ho Chi Min » avec une flèche. Lorsqu’ils ont quitté, je suis entré—et j’imagine que personne n’avait nettoyé la place car ça traînait là sur le plancher, et ils étaient partis. Je l’ai ramassé et l’ai ramené à la maison. Ça ne dit pas Fugs dessus ou rien, juste un Sentier Ho Chi Min Trail fait maison avec une flèche. Ils ont joué deux fois là, chaque fois ce fût durant une semaine.
LR: Vous deviez être bien placé au Penelope ?
AY: C’est vrai. Tous les soirs où l’endroit était ouvert, je travaillais à la porte. Ma routine était que j’étais au centre-ville, à chercher un moyen de me défoncer. On buvait de la bière, on fumait du pot…
LR: J’avais entendu dire que Satan’s Choice avait la plupart du pot.
AY: Non, Satan’s Choice dans ce temps-là comptait 3 ou 4 gars max, et pour un certain temps ils n’avaient qu’une motocyclette qu’ils partageaient. Leur clubhouse se tenait autrefois sur Prince-Arthur. Il y a une très belle maison là-bas transformée en condo, ils ont construit à l’arrière, mais c’était leur espace pendant environ 18 mois avec l’unique motocyclette à l’avant.
LR: Alors est-ce que vous alliez au Dominion Square, par exemple ? Comment faisait-on pour trouver l’équivalent de 10 $ de pot à cet époque-là ?
AY: Bien, à [Ville] St-Laurent, où nous avions tous des amis. Et le centre-ville était bizarre. Je n’ai jamais fait la promenade pour chercher du pot. J’avais toujours un ami qui avait du pot. Le centre-ville était un peu bizarre pour ça, même si c’était assez ouvert, mais souvenez-vous que j’étais jeune à l’époque, et de [Ville] St-Laurent, et c’était tout nouveau pour moi ici. Ma vie se passait à [Ville] St-Laurent. C’est drôle, je prenais de la drogue au centre-ville, puis retournais à [Ville] St-Laurent et puis j’ai découvert, oh, vous trouviez ça ici aussi !
En fait—en y repensant—je n’en ai probablement pas acheté beaucoup. Il y avait un gars qui avait écrit un livre… Denis Vanier ? Il avait une coupe afro, et si j’avais 5 $, j’allais le voir et lui demandais : « J’en veux pour 5 $ de pot » et il disait : « Combien de personnes vont en fumer ? » et ça déterminait la taille du sac qu’il me donnait !
LR: Ça c’est une réponse des années 1960. Alors, vous étiez au centre-ville, à flâner… ça devait être excitant de faire partie de la scène et de travailler à faire la porte des concerts. Était-ce pareil à aujourd’hui où ils étampent [à l’encre] votre main ?
AY: Non. On n’étampait pas les mains des gens. Vous gardiez le talon de votre billet. Étamper la main aurait épargné beaucoup de travail. Gary avait une vieille boîte de film venant d’une salle de cinéma. On déchirait le billet en deux et l’autre moitié allait là-dedans. C’était une époque intéressante. J’aime la musique et je suppose que je suis stupidement honnête, ce que j’ai déjà été… parce que je ne laissais personne se faufiler à l’intérieur… non… « Voilà, je te donnerais ça si tu me laissais entrer »… Je ne faisais tout simplement pas ça. Tout le monde a tendance à arnaquer tout le monde.
LR: Avez-vous déjà été trop honnête, jusqu’à aller dire : « Ce groupe est pourri, les gars » ?
AY: J’ai été brutalement honnête parfois et j’aurais probablement dû me taire, mais vous savez, parfois l’arrogance a besoin d’un coup dans les boules ! (rires)

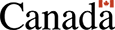
Je me souvient bien de Mike Bloomfield jouant avec Paul Butterfield. Il jouait complètement absorbé dans son voyage. Il était vètu d'un chemisier mauve pâle en bas de la ceinture et ses cheveux. Quelle image !
Bravo pour ce blog.