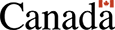Ken Norris, Poète de Véhicule
LR: Est-ce une équipe éditoriale ou juste vous et votre coéditeur qui lisait et sélectionnait ensuite les œuvres ?
KN: Au début, Jim et moi sélectionnions ensemble les poèmes pour les revues et les livres pour la presse. Après un certain temps, en devenant plus confiants, on a commencé à prendre des décisions individuellement. Il y avait des numéros entiers que j’ai édités à Montréal et des numéros entiers qu’il a édités à New York. Où la revue était produite, dans quel pays, dépendait de l’organisme artistique qui finançait le numéro, et de quel imprimeur dans ce pays nous offrait le meilleur prix. Lorsqu’un numéro sortait, on envoyait deux copies à chaque contributeur—par la poste !
LR: Je suis tout particulièrement intéressé à savoir comment ça a fini par être imprimé sur les presses de Véhicule. Ils était une coop—cela voulait-il dire que vous deviez payer des frais réguliers pour l’utiliser, ou payer le gars de la presse pour l’utiliser ? Fournissiez-vous le papier ? Comment c’était imprimé, puis collationné, puis relié, etc. ?

Ken Norris, Artie Gold et leur amie Carol au Vieux Montréal, au milieu des années 1970, photo par Endre Farkas.
KN: J’étais sur le comité éditorial de Véhicule Press autour de septembre ou octobre 1975. Mais lorsqu’il s’agissait d’apporter la revue CrossCountry, par exemple, à l’imprimerie de Véhicule, j’étais juste un client parmi d’autres. Donc mon point de vue de l’imprimerie, en tant que maison d’édition et éditeur de CrossCountry, était et est celui d’un client. Il se peut qu’ils se soient organisés selon le modèle d’affaire d’une coopérative, mais en tant que client, il s’agissait d’un imprimeur parmi d’autres. Ils avaient besoin d’assez d’argent pour payer les salaires et payer leurs factures alors ils se devaient de faire un profit sur chaque travail d’impression qu’ils réalisaient. Alors, en tant que maison d’édition et éditeur de CrossCountry, je les ai embauché pour faire un travail comme j’aurais embauché n’importe quel autre imprimeur. Et on s’attend au même degré de professionnalisme que s’attendrait de la part de n’importe quel autre imprimeur. Alors leur travail était de collationner et relier. Ils livraient un produit fini pour un prix spécifique et je payais la facture.
Lorsque je portais mon chapeau d’éditeur de Véhicule, c’était tout autre chose. Parce que j’étais, à cet instant, un employé non payé de Véhicule Press. J’ai sélectionné et édité pour eux des manuscrits, et ils assumaient les risques financiers, les avantages et les responsabilités liés au fait d’être une maison d’édition. En ayant leur propre presse à imprimer les aidait à garder leurs coûts bas.
Je suppose que, des 16 numéros de CrossCountry, peut-être cinq ou six d’entre eux étaient imprimés à Véhicule. Les premiers étaient imprimés à New York, le dernier à Coach House à Toronto, puis quelques-uns entre les deux au Michigan.
LR: Vous mentionnez l’Eldorado—ceci est-ce ce qui était décrit comme une sorte de cafeteria avec des machines distributrices? Alliez-vous aux places de hot-dogs du coin de la rue (Coin Doré, Frites Dorées, Poolroom) ou au Woolworth de l’autre côté de la rue pour le lunch? Y avait-il de vieilles tavernes dans le secteur que les artistes et poètes fréquentent pour des pintes pas chères après les évènements ou les lectures?
KN: Je ne dis pas qu’il n’y avait pas de machines distributrices à l’Eldorado, mais s’il y en avait, honnêtement, je ne m’en rappelle pas. J’avais ma « diète Eldorado » —et c’était un sandwich au bacon et aux œufs frits sur pain blanc et un rouleau au pacanes. Je ramassais ça directement au comptoir. Ils faisaient frire les œufs et le bacon devant mes yeux et ils coupaient le rouleau de pacanes en deux et l’enduisaient de beurre. Et j’imagine que je complétais ça avec un petit carton de lait, mais je suis en train de faire des suppositions. C’était du thé.
Je n’ai jamais mangé à Woolworth’s. Jamais. Quand Artie Gold était à la presse ou à la galerie pendant la semaine—ce qui était rare—on était définitivement au coin de la rue avec les hot-dogs et les frites.
Nous sommes allés au moins à quelques reprises dans une taverne au coin de la rue Saint-Laurent. Nous avons eu des rencontres informelles là-bas et une fois nous y avons écrit un poème collectif.
LR: Je ne suis pas certain que vous le sachiez, mais presque tout ce bloc est prévu d’être démoli pour faire place à des tours à condos. Est-ce que vous ressentiriez des regrets en apprenant la démolition du quartier où se situait Véhicule Art, ou serait-ce simplement un autre changement d’époque …
KN: Personne n’aime entendre parler de démolition des lieux sacrés de leur jeunesse. C’est horrible, terrible, triste. Mais vous en avez vu passer beaucoup lorsque vous arrivez dans votre soixantaine. La moitié des endroits où j’ai vécu à Montréal a été démolie. Artie a disparu dans l’univers. L’endroit où je vivais juste en bas de la rue de chez lui a été démoli. Je ne sais pas si l’endroit où il vivait dans le ghetto McGill est encore là ou non. Prochaine fois que je suis en ville je jetterai un coup d’œil. Mais je suis encore dans la galerie, et la galerie est encore en moi.