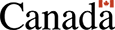Ken Norris, Poète de Véhicule
LR: À part le centre d’artistes Véhicule et les universités, y avait-il des cafés ou des lieux où vous et/ou d’autres écrivains trainaient, s’inspiraient, regardaient passer les gens ou absorbaient des lectures?
KN: La toute première fois que j’ai fait une lecture de poésie, c’était à la librairie The Double Hook à Westmount au printemps 1975. J’ai partagé la lecture avec Claudia Lapp. La première lecture solo que j’ai fait, plus tard au cours de cette année-là, était au The Word bookstore. Alors les librairies étaient vraiment importantes. Artie Gold et moi avions l’habitude de traîner autour de The Word. Artie était là quasiment tous les jours, parce qu’il vivait juste en haut de la rue, et après ma journée d’enseignement terminée à McGill, je me dépêchais d’aller à The Word, pour voir quels nouveaux livres venaient de sortir, ou ce qu’il y avait de nouveau dans la section poésie.
LR: Vous rappelez-vous de la première fois que vous avez marché vers l’espace de Véhicule—ce secteur était encore le Red light district, n’est-ce pas?
KN : Il y avait des prostitués sur la rue Sainte-Catherine, et il y en avait plus en soirée. Le Red light district est un peu trop criard—c’était un quartier délabré, c’est pourquoi la galerie était situé là—loyer pas cher. Je ne pense pas que ça m’ait marqué plus que ça. J’étais davantage intrigué par les sandwichs aux œufs frits et aux rouleaux de pacanes chez Eldorado!
Véhicule Press était situé dans l’arrière-salle de la galerie. Il n’y avait pas grand chose à y voir. Il y avait quelques presses d’imprimerie, une grande et une plus petite, quelques personnes en train de travailler.
« L’espace bureau » était situé à l’étage supérieur. La Presse était située à l’arrière. Il y avait un vieux piano désaccordé. Les fins de semaines, le chauffage était éteint, alors si vous alliez à l’une des séances de lecture de poésie un dimanche en hiver, vous gardiez sur vous votre manteau, et si vous étiez en train de faire la lecture vous gardiez aussi sur vous votre manteau. « Véhicule Art » était écrit en néon à hauteur de rue, et vous deviez escalader de formidables escaliers pour monter à la galerie. Je dois avouer que j’ai eu le coup de foudre pour la galerie. J’adorais tout simplement cet espace. Peut-être que le musicien en moi ressentait toute l’ambiance jazz d’autrefois. Il y avait une bonne atmosphère. L’endroit semblait être un lieu de toutes les possibilités.
LR: Ayant été autrefois une discothèque en décomposition, je présume que Véhicule a dû se sentir comme un lieu de transition, se lançant une pratique culturelle entièrement nouvelle dans un secteur de la ville qui a vu le meilleur de la vie nocturne et de l’époque des cabarets des années 1920 à 1950.
KN: Le passé avait été effacé déjà. La première génération d’artistes avait fait un fabuleux travail de rénovation de l’espace. Et les œuvres d’art étaient toutes des choses alternatives, expérimentales, parfois excessivement étranges, des choses tout simplement follement conceptuelles. Les galeries parallèles étaient établies comme une ALTERNATIVE aux galeries commerciales conventionnelles, et Véhicule a définitivement profité de son statut alternatif. Nous y sommes tous entrés comme un certain genre de poète et en sommes sortis comme un autre genre de poète à cause de notre exposition à l’art, l’atmosphère du conceptuel, la permission et l’obligation d’être absolument à jour. Il y a une certaine tendance en poésie qui tend vers le traditionalisme, tendance que la galerie chassa des Poètes de Véhicule. J’étais assez conservateur dans mes tendances artistiques avant d’arriver à Véhicule.
Et tout ça a été abandonné très rapidement. En partie dû aux poètes avec qui je parlais, comme Artie Gold et Tom Konyves, mais aussi beaucoup était dû à l’environnement dans lequel je me trouvais. En 1975, je me trouvais à la galerie, pour une raison ou une autre, environ six jours sur sept par semaine. Je n’étais presque jamais là les samedis. Alors je me rapprochais des contenus expérimentaux de la galerie presque quotidiennement. Cela a commencé à faire des drôles de choses à l’intérieur de ma tête.
LR: Vous avez mentionné avoir dirigé le petit magazine CrossCountry—afin de comprendre comment on pouvait s’adonner à une telle activité sans recours aux logiciels de traitement de texte et de mise en page, ni Photoshop ou imprimantes laser ; comment est-ce qu’on pouvait bien gérer ça ? Quelles étaient les étapes au milieu des années 1970 afin de mettre en place et puis produire des numéros d’un nouveau périodique ?
KN: Croyez-le ou non, il y avait une vie avant les ordinateurs personnels. Le magazine CrossCountry a opéré pour seize numéros (1975-83) et CrossCountry Press a produit vingt-trois livres à peu près dans le même laps de temps. Nous avons démarré le tout avec un financement de 300$. Autrefois, on embauchait des typographes pour typographier et des imprimeurs pour imprimer. Ceci dit, j’ai fait beaucoup de typographie lorsqu’on me donnait accès aux équipements. Mais les imprimeurs à New York, Montréal, Toronto et Michigan imprimaient nos magazines et livres, selon qui rentrait avec le l’offre du prix le plus bas.
Ça a commencé de la même manière que tout commence, avec un groupe de personnes qui disent, « pourquoi ne pas commencer notre propre petit magazine ! » Et tout part de là.
LR: Je présumes que quelques-unes de ces étapes incluent : trouver un nom, un politique pour les soumissions, l’envoi (par la poste ? grâce au bouche à oreille ?) d’appels à soumissions, décider d’un prix et de la manière de distribuer le magazine (distributeurs ? consignation dans quelques magazines locaux ? abonnements ?), s’il atteindrait le seuil de la rentabilité (en supposant qu’aucun des auteurs ne serait payé, et que « rentable » signifie même juste le remboursement de l’impression et des coûts d’envoi postal).
KN: C’est bien ça. Parlons-en. Jim Mele était à New York et moi j’étais à Montréal. Comme nous le disions, nous en avons parlé et avons décidé que nous voulions avoir un magazine dont le focus était autant sur la poésie canadienne qu’américaine. Nous ne réalisions pas que nous marchions tout droit vers un champs de mines, mais nous en parlerons plus tard. Alors nous devions trouver un nom, nous l’avons donc appelé CrossCountry, sans espace entre les mots. Je ne peux pas vous dire combien de courrier indésirable nous avons reçu en l’espace de 10 ans, en lien avec le ski de fond (cross-country, en anglais) !
Jusqu’en 1990, les auteurs vivaient leur vie via la poste. Tout passait par la poste. Tu envoyais ton manuscrit aux magazines ou éditeurs par la poste. Tu recevais tes acceptations ou refus par la poste. Tu envoyais des lettres à d’autres auteurs. La correspondance littéraire constituait une partie importante de ma vie. Les magazines et les livres arrivaient par la poste. Et ainsi de suite.
Après avoir trouvé un titre pour notre magazine, la première chose qu’on a fait était d’essayer de dégoter des abonnements institutionnels. Par voie postale. Je ne me souviens pas combien de bibliothèques et d’universités nous avons tenté de contacter. Je pense que nous avons reçu 100 réponses résultant en 100 abonnements. C’est par là qu’il fallait commencer.
Nous avons contacté des auteurs qu’on aimait—par la poste—et leur avons demandé de nous envoyer leurs œuvres. Plusieurs l’ont fait. Nous avions alors pris notre envol. Les premiers numéros étaient distribués manuellement chez les libraires indépendants à New York et Montréal. Arrivé au cinquième numéro, nous avions une distribution de petite presse au Canada et aux États-Unis.
Tu pouvais être essayer d’être rentable, ou trouver assez d’argent pour imprimer le prochain numéro. Mais là les organismes subventionnaires entraient en scène : Le Conseil des arts du Canada et le National Endowment for the Arts. Pendant un certain moment ils aimaient ce qu’on faisait, alors on recevait du financement. Lorsqu’ils étaient fatigués de nous, et que tout l’argent était dépensé, on a fermé le magazine et la presse. Mais nous avons bel et bien réalisé quarante publications en huit ans—c’est pas mal.