Juan Rodriguez légendaire journaliste rock et son Pop See Cul
LR: C’était durant l’été de 66, n’est-ce pas?
JR: Oui. Il y avait The Lovin ‘Spoonful sur la couverture.
LR: Nous en avons une copie grâce à Francois Dallegret, mais elle est en mauvais état. Est-ce que Andrew Callum est toujours actif ? Un de vos anciens collègues en a peut-être encore des copies ?
JR: Andrew est toujours par ici, il pourrait l’avoir. Ma mère en a peut-être encore quelques-uns à Londres.
LR: Celui-ci dit numéro trois, automne ’66. Qu’est-ce qui vous a inspiré à publier votre propre magazine?
JR: Tout le monde le faisait. À un moment donné, nous étions presque membres du Underground Press Syndicate. Ça paraissait tout à fait naturel, c’était la chose que je voulais faire. Vous avez peut-être remarqué que j’ai un léger bégaiement, et bien, c’était terrible quand j’étais enfant. Absolument horrible. On riait de moi, et je suis convaincu que c’est ce qui m’a donné envie d’écrire. J’ai toujours eu quelque chose à dire.
LR: Il y avait plus de musique pop que de politique…
JR: Mais j’aimais juxtaposer des trucs de type pop avec des sujets plus sérieux. Là nous avons un article de Buckminster Fuller… Ici, vous voyez Crawdaddy, le magazine de rock lancé par Paul Williams, qui nous a donné une des pièces de Paul en échange d’une publicité.
Et puis ici, je ne sais pas si vous vous souvenez de l’arbitre de hockey Red Storey? C’est son fils, Doug Storey. Dans sa famille, Doug était le type bizarre il s’intéressait à la musique et à toutes ces autres affaires. Il a réussi à s’infiltrer dans la clique d’Andy Warhol.
AT: Il n’a pas pris ces photos lui-même, n’est-ce pas?
JR: Non, mais elles traînaient là-bas et il les a ramassés, et donc nous publiions : « Exclusif! »
DD: Tu mentionnais l’autre jour que tu avais trouvé du contenu de Pop-see-cul dans un livre sur Andy Warhol et le Velvet Underground?
JR: Oui, je suppose que ce livre est sorti il y a environ deux ans. Au milieu, il y avait une copie d’environ six pages de Pop-see-cul, comme un petit collage, Gary Eisenkraft avait publié ça. C’est drôle, parce qu’il nous avait promis de faire la mise en page et il a réussi à obtenir beaucoup de Mr Péladeau, car à cette époque, tout ce que Péladeau avait était le Journal de Montréal, qui venait de débuter en raison de grèves à La Presse. Ils cherchaient donc des contrats pour l’imprimerie. Gary a en imprimé quatre mille, c’était la plus grosse impression que nous n’avions jamais fait, énorme, immense. Mais malheureusement, Gary n’était pas si bon distributeur, et la plupart d’entre eux ont été laissés en piles. Il fallait toujours aller d’un magasin à l’autre, vous savez, « Voulez-vous prendre cela sur vos tablettes? »
LR: Le Metropolitan News par exemple ?
JR: Ouais, Metropolitan News était un des gros magasins, mais il y avait aussi la librairie Classics qui distribuait le Village Voice, et quand on passait là, ils achèteraient une pile entière. Rien n’y faisait, il avait toujours ces piles de magazines dans son couloir. L’appartement était au troisième étage, à côté du bâtiment Holt Renfrew, où habitait sa petite amie Melinda. Ils ont filmé The Ernie Game là-haut, dans cet appartement, et il y a cette scène, où vous regardez dans le couloir, et les magazines sont là.
AT: Donc c’est pour ça que personne ne peut en trouver une copie ? Parce qu’ils sont tous restés là.
JR: Oui, c’était un flop (feuilletant des copies de Pop-see-cul). Voici un autre article: Arthur Bardo était le critique d’art pour The Montreal Star qui a déménagé ici de New York. Il a été très rude avec la scène artistique locale, il a écrit un article pour Pop-see-cul qui s’intitulait «Pourquoi le Grand Art n’a jamais émergé à Montréal ». Il s’est officiellement tiré dans le pied.
Il y avait aussi une lettre ouverte à Leonard Cohen par Robert Hirschhorn, qui était un grand éditeur.
Le Château était vraiment contrarié à propos de cette publicité-ci. Herschel Segal était le propriétaire du Château et il soutenait le magazine. Nous avions de vrais bureaux sur Crescent Street, Sidney Rosenstone avait quelques bureaux juste au-dessus d’où Ziggy est maintenant. Donc nous avons reçu ce type de New York qui a déménagé à Montréal, Larry Schnitzer, un skinhead qui était très drôle. Nous n’avions pas d’art original sauf le logo Le Château, et c’est donc Larry qui a esquissé la chose, et nous l’avons publié… Hershel était si en colère !
LR: Donc il n’a pas aimé, mais encore une fois, il vous a dit de faire ce que vous vouliez, n’est-ce pas?
JR: Oui, c’est ce qu’il avait dit. Ici on voit Richard Meltzer, qui est connu pour son livre The Aesthetics of Rock.
LR: Avez-vous republié cet article ?
JR: Non, c’est un article inédit. Meltzer est l’un de mes meilleurs amis. Dans ce temps-là, vous savez, nous devions étaler les feuilles pour les mettre en page…
LR: Ah, nous avions l’habitude de faire pareil avec mon propre zine Fish Piss dans les années 90, je pense que nous essayions de faire la même chose à différentes époques. Un mélange de politique avec musique et culture…
JR: Oui, Fish Piss, oh wow, je lisais ça…
AT: Avez-vous déjà vu ce magazine, Pop-Cycle ? Je l’ai obtenu d’Alain Simard, il m’a confié que la raison pour laquelle ils ont choisi ce titre pour le premier et seul numéro de ce journal, était à cause de votre périodique Pop-See-Cul. Et c’était en 71, alors que votre magazine était en train de s’éteindre.
JR: Ça c’est quelque chose, Pop-Cycle.
AT: Quand il m’a parlé de ça, j’ai dit non, ça ne peut pas être vrai, il doit parler de Pop Rock Jeunesse…
JR: J’ai écrit un article en français pour Pop Rock, un tabloïd similaire publié par Coco Jacques Letendre. C’était un grand passionné de musique, et j’avais réussi à obtenir une entrevue musicale exclusive avec Robbie Robertson. Ils l’avaient dans Pop Rock, et j’avais ma version dans The Montreal Star. C’était toute une histoire en soi. Robbie vivait dans le quartier de Côte-des-Neiges, avenue Jean Brillant, avec sa petite amie Dominique. Et il a passé un hiver ici. Nous nous sommes réunis, elle m’a appelé au Montreal Star et m’a dit qu’il voulait faire une entrevue avec moi pour un projet qu’il avait en tête. Nous sommes allés à ce restaurant pour parler d’un film sur l’origine de The Band et d’autres sujets similaires. Il voulait un article pour essayer d’obtenir du financement canadien pour ce film, mais ceci lui a été refusé. Alors il est allé à Hollywood faire La dernière valse. Robbie, sachant que j’avais fait de mon mieux, m’a invité à La dernière valse gratuitement. Tout a été payé par Capitol Records. Je me souviendrai toujours de ce concert où tout le monde était là, Van Morrison, Eric Clapton, Joni Mitchell. Je n’avais jamais vu autant de cocaïne de toute ma vie. C’était tout simplement incroyable. Vous avez sans doute entendu l’histoire de Martin Scorsese qui a dû corriger sur la pellicule un rocher qui pendait du nez de Neil Young. Ils devaient le supprimer manuellement, image par image. Et je me souviens avoir pris l’ascenseur avec Eric Clapton, et Eric Clapton était appuyé sur l’ascenseur, juste comme ça. (pose) C’était vraiment de la super coke. C’était fantastique. Je me souviens de Peter Goddard du Toronto Star, nous étions les deux seuls journalistes présents. J’étais dans un coin de la pièce, vous savez, à préparer un peu de coke, et Peter n’avait jamais essayé. Il la renifle et il fait « Ah-choo! », il y avait de la coke qui volait partout… (rire). Ça a été la dernière fois que j’en ai fait avec Peter. Durant La dernière valse, je me suis dirigé vers le Cow Palace presque derrière la scène, pour regarder en contrebas, et la seule autre personne présente était Michael J. Pollard du film Bonnie et Clyde. Alors nous nous sommes assis ensemble, il avait un peu de mauvaise herbe, j’avais un peu de coke, et nous avons fait notre truc, sans même nous parler… Et quand Robbie m’a vu au cours de la répétition, j’ai dit « Comment est-ce que les choses vont ? » Et il a dit « Eh bien, ça va très bien, tout est bien arrangé, dans la poche. » (Rires). Ça se passait comme ça. C’était vraiment le sommet des années soixante-dix. De mon point de vue, et je crois que j’ai raison, lorsque les Beatles sont arrivés en Amérique du Nord, l’industrie elle-même n’était pas prête. Ils n’avaient pas assez de presses pour produire les albums. Ils ne pouvaient pas gérer la demande.
AT: C’est vrai, il semble que malgré tout ce qui s’est passé dans les années cinquante, la machine n’a pas grandi assez vite pour accommoder l’invasion britannique.
JR: Ils ont continué à hisser tous les Bobbies sur nous: Bobby Vinton, Bobby Vee, tous, et ils ont essayé de tuer le rock and roll : en mettant Chuck Berry en prison, et ils ont banni Jerry Lee Lewis à cause de son cousin de treize ans. Merde, qui remplaçait les Beatles à la première position des palmarès ? The Flying Nun. C’est ce qu’ils nous ont imposé, vous savez? Et donc, boom !
Donc, tout a commencé à accélérer, très, très vite. Nous avons eu le son de la côte ouest, nous avons eu le bruit de Boston, nous avons eu New York, The Velvets venaient de se former, et c’est dans les années soixante-dix que l’industrie elle-même a explosé en un monolithe. C’était la grande époque des chanteurs-compositeurs, les premières pierres du rock heavy. Et c’est ce qui a construit l’industrie, des personnes comme Carole King et tous ces gens-là, un auteur-compositeur-interprète après l’autre, James Taylor, je ne pouvais en supporter aucun. Mais c’est devenu une méga, méga, méga industrie. Mon ami Meltzer dit que le rock and roll s’est plus ou moins arrêté en 1968. Tout ce qui a suivi est soit de la mousse soit de la merde. Et la machine de hype était incroyable. À l’époque, les journalistes se faisaient acheter des articles.
Durant ma première semaine au travail chez The Star, j’avais écrit six textes comme pigiste pour The Gazette, de petits articles, mais j’ai fait le premier article sur Jesse Winchester, c’était la première fois qu’on parlait de lui dans les journaux. Après que les six soient sortis, j’ai finalement appelé le rédacteur en chef en demandant : « pensez-vous que je pourrais être payé pour ça ? » Et il a dit, « Oh ok, quinze dollars par texte, mon poulet. » C’est exactement ça. « – Oh, merci monsieur, merci beaucoup. »
DD: Tu étais maintenant un professionnel, non ? Lorsqu’on est payé, on est un professionnel.
JR: Exactement. Puis, en 69, j’ai décidé d’aller à Londres, c’était là que les choses se passaient. J’y ai vécu pendant six mois. À cette époque, The Stones se séparaient de Brian Jones. J’ai appelé le bureau des Stones et j’ai dit: «Je suis ici du Montreal Star, puis-je faire une entrevue avec The Stones ? », et ils n’ont pas dit non. Le secrétaire a dit: «Nous allons faire une annonce importante dans quelques semaines, laissez-moi vous mettre sur notre liste.» Et à n’y pas manquer, quand je suis allé à leurs bureaux sur Warder Street j’ai été introduit comme le représentant international, ils ont présenté Mick Taylor, et c’était la première fois que je m’entretenais avec The Stones.
AT: Saviez-vous que [la chanteuse montréalaise] Nanette Workman était à Londres à la même époque, et qu’elle a chanté sur Honky-Tonk Woman ?
JR: Et aussi sur Midnight Rambler.
AT: Vous saviez qu’elle était à Montréal avec Tony Roman et tous ces gens-là ?
JR: Tout à fait. Je connaissais très bien Tony, très bien. En mars 69, j’ai dit à The Star : «Si je vous donne une entrevue avec The Rolling Stones, allez-vous m’engager comme critique pop ?» Ils n’avaient pas de critique de culture populaire dans ce temps-là. Avec le recul, c’est vraiment le moment où tout le monde a commençé à embaucher des critiques pop. Quand il y avait des concerts, ils demandaient au critique de théâtre d’écrire sur le sujet, ou bien au critique de danse. Donc, sans surprise, j’ai été engagé en septembre 69. Le premier spectacle sur lequel j’ai écrit était The Doors au Forum et Jim Morrison était tellement ivre que The Doors n’arrêtait pas entre les chansons, ils embarquaient sur le prochain morceau, comme pour finir le concert le plus rapidement possible. Et il fallait que je rédige une critique, et le titre était «Doors Bore, but Boppers Lap It Up» (Des fans en béatitude devant des Doors ennuyeux) J’en ai obtenu, du courrier des lecteurs !
AT: Vous devez avoir reçu beaucoup de courrier haineux. J’ai lu les critiques de Led Zeppelin, The Kinks, Bowie, et les autres, comme tous ces fans… The Kinks à l’auditorium du FC Smith en 69 ou 70… Et je pensais : «Ce type doit avoir eu beaucoup d’ennemis. »
JR: C’était délicieux, j’étais le type qu’on aimait haïr. Et c’était surtout le battage médiatique autour des Kinks qui m’énervait, parce que les Kinks, pour moi, à ce moment-là… C’est simple, je préfèrais leur musique mieux que tout autre groupe de l’invasion britannique. Ça transcende le mot «classique», c’est du vrai rock and roll, vous comprenez? Leurs premiers succès ont été fantastiques, et Ray Davies, quand il a commencé à écrire sur les problèmes de société et toutes ces choses qui émergeaient, personne n’avait encore parlé de lui dans les médias. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai toujours pensé que les Beatles étaient complètement surestimés et je le crois encore aujourd’hui.
AT: Ils n’écrivaient pas de chansons pertinentes pour les gens?
JR: Les Beatles étaient un phénomène, et il y a une distinction à faire entre la musique et le phénomène. Ils ont été un phénomène incroyable, ils ont été un catalyseur incroyable, on ne pourra jamais en dire assez là-dessus. Mais en ce qui concerne les chansons, j’ai adoré leurs reprises Motown de leurs débuts, mais par la suite, leurs chansons comme « Please Please Me » et « Love Me Do » n’étaient pas des morceaux très substantiels.
Et j’ai toujours pensé que Sergeant Pepper était un album de merde, à part une chanson, «Day in the life», que jevoyais comme un chef-d’œuvre. Et ce que je commence à sentir maintenant que dans les sondages, où «Sergeant Pepper» était toujours l’album numéro un, c’était systématique ; et bien dans le dernier numéro du magazine Uncut, ils ont les deux cents meilleurs albums de tous les temps et Sergeant Pepper se retrouve au numéro vingt et un. Il a donc perdu sa popularité maintenant.
Rubber Soul était bon aussi. Je me souviendrai toujours d’une nuit pluvieuse à Montréal, c’était au mois de novembre 65 quand Rubber Soul est sorti, hein? Et je suis allé à Archambault, parce qu’Archambault avait le magasin de disques à la Place Ville Marie, j’y ai acheté Rubber Soul et j’ai aussi acheté Soul Meeting de Ray Charles et Milt Jackson. Jazz et pop. Et je me sentais tellement fier de moi-même, que je puisse aimer les deux à la fois.
Rubber Soul était un album très sophistiqué et très bon. Mais, vous savez, à cette époque The Stones ont fait des choses bien mieux, Beggar’s Banquet, Let It Bleed, ce sont des albums fantastiques. Il n’y avait rien à jeter.
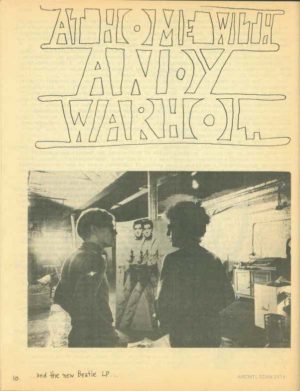


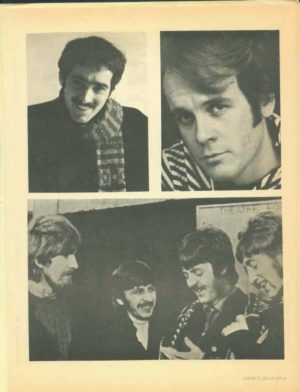

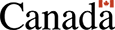
Nanette étant originaire de Jackson.C'est du moins ce qu'elle raconte dans son autobiographie.