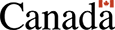John Heward
John Heward en conversation avec Louis Rastelli au Café Résonance, été 2016.
JH: Je suis d’ici, du Golden Mile, rue Redpath. Il y avait des maisons en rangées construites dans les années 1920, et quand nous étions là au début, il y avait beaucoup de grandes maisons, aux alentours de Sherbrooke. C’était une rue fermée à l’époque, un ponceau. Ils avaient repoussé [Doctor] Penfield et c’était une rue tranquille.
LR: Ça devait être un quartier intéressant où grandir, vu que c’est littéralement à un pas du centre-ville et de toutes les boîtes de nuit…
JH: … et tout cela.
LR: Est-ce que la scène jazz était toujours aussi vibrante lorsque vous êtes arrivé à l’âge adulte ?
JH: Ouais ! Je sortais tard le soir, souvent pour aller à des clubs de jazz, et des associations qui se rencontraient en après-midi. Les musiciens avaient des concerts, vous savez, en après-midi ils se pratiquaient un peu plus.
LR: Avez-vous eu la chance de voir des concerts de jazz dans des salles légendaires telles que le Rockhead’s ?
JH: Oui. Je traînais au Rockhead’s un peu, et j’étais très jeune—15 ou 16 ans—à l’époque où ils passaient les Rockettes, un trio de danseurs, un comédien et un spectacle. Il y avait Louis Metcalfe dans le groupe, un trompettiste qui jouait avec Ellington. Il y avait des sessions après le dernier concert, et je restais là pour ça… C’était juste le groupe de musique et des gens assis.
LR: Ça ne les dérangeait pas d’avoir un jeune—qui restait si tard ?
JH: Pas dans ce temps-là.
LR: J’ai entendu dire par certains musiciens alors actifs que dans les années 1970, malheureusement, Rufus Rockhead n’était pas le gars le plus tolérant. L’une des histoires qu’on m’a racontées est celle d’un groupe de genre funk blanc qui voulait jouer dans ce lieu et on leur a tout simplement dit : « Pas de Blancs ! »
JH: Bien sûr, la communauté noire sortait également au bar, un beau et long bar, en bas…
LR: N’y avait-il pas également une piste de danse renfoncée ou quelque chose du genre ?
JH: Bien, le rez-de-chaussée était simplement une salle en longueur avec un bar très long, où ils recevaient des trios et ainsi de suite. Puis tu montais les escaliers jusqu’au second étage, où se trouvait le club avec la piste de danse et une scène, et puis il y avait le troisième étage qui était un peu comme le balcon, qui faisait tout le tour de la salle. Il n’y avait pas tant de tables en haut parce que c’était plutôt exigu, mais il y avait une sorte de grand puits… Je pourrais dire que j’avais une sorte de relation avec Rockhead’s et je n’allais pas vraiment de l’autre côté de la rue—à part peut-être une ou deux fois—au Café [ST-MICHEL], qui était comme une version plus brute du Rockhead’s… On ne m’a jamais dérangé.
LR: Vous n’avez réellement commencé à jouer de la musique vous-même que beaucoup plus tard…
JH: Non, ça c’était beaucoup plus tard. J’avais quelques disques et j’ai commencé à jouer de la batterie autour de 16 ans environ, mais c’était très informel.
LR: Vous étiez un aficionado du jazz ?
JH: J’écoutais le jazz.
LR: Comment faisiez-vous pour suivre ou savoir qui allait venir en ville ?
JH: J’essayais de suivre, mais j’ai raté beaucoup de concerts dans les années 1960, parce que j’étais parti en Angleterre, à Londres, pour un certain nombre d’années, pour faire de l’édition… et des gens comme Albert Ayler sont venus [1967] et je les ai raté. Je connaissais assez bien la scène [JAZZ] de Londres.
LR: Qu’est-ce qui vous a amené à faire de l’édition ? C’était ça que vous aviez étudié à Montréal ?
JH: Bien, j’ai étudié à l’Université Bishop et j’avais un diplôme en Études anglaises, et je ne savais pas trop quoi faire avec ça.

LR: Alors vous étiez là-bas à Londres à l’époque du swing ?
JH: Non, pré-swing—fin des années ‘50 et au tout début des années ‘60—c’était très intéressant parce que c’était à la sortie de la guerre et il y avait encore cette atmosphère de guerre… beaucoup de décombres. J’ai décidé que j’allais essayer d’entrer en édition. Ça semblait être une vie agréable, lire et dire « oui » ou « non ». Londres et New York étaient assez équivalentes, mais c’était avant l’époque de l’édition corporative.
LR: Avant Penguin et Random House ?
JH: Bien, j’ai travaillé pour Penguin et ça c’était avant qu’ils ne deviennent gros et mauvais. Je connaissais Alan Laing.
LR: Comment cela marchait-il pour ce qui était d’avoir les moyens de subsister, et ramener un CV ? Ou aviez-vous l’objectif de rester là pour toujours ?
JH: Je ne savais pas. J’ai presque failli rester, mais quelque chose me tracassait… l’édition était amusante, j’y prenais plaisir dans une certaine mesure, mais c’était littéralement mon deuxième choix, ce n’était pas parfait et je savais que je n’allais pas être écrivain.
LR: Étiez-vous éditeur, correcteur d’épreuves ?
JH: J’étais en quelque sorte un compagnon, un stagiaire. J’avais mon mot à dire sur certaines choses. Je pouvais mettre de l’avant des livres qui me plaisaient. En fait, l’historique officiel des éditions Penguin ne le mentionne pas, mais je suis celui qui leur a amené Under The Volcano ! Le livre de Malcolm Lowery, ça avait été publié, oh, autour de 10 ou 15 ans auparavant—à la fin des années 40, 1949—par Hamish Hamilton… ça avait attiré l’attention de certaines personnes et c’était un livre quelque peu underground… Lowery est mort en 1959 et Penguin sortait tout juste de l’affaire Lady Chatterley, ils avaient gagné le procès [judiciaire] afin de le publier et ça a ouvert beaucoup de portes. Toute la vie sexuelle anglaise est une histoire fascinante à suivre, l’amour dans un climat froid. Écrire et publier est une drôle d’affaire. Je suis revenu ici en visite en 62, et j’ai décidé que je ne voulais pas vraiment rester dans l’édition et qu’il y avait quelque chose qui me démangeait, alors j’ai eu d’autres emplois, j’ai travaillé en architecture pour quelques années, et puis j’ai été embauché pour faire du contenu thématique pour le Pavillon canadien à Expo, alors j’ai fait ça.
LR: Travailliez-vous avec une équipe ?
JH: Ouais, on développait les idées et on réfléchissait à comment ces idées pouvaient être exposées et comment elles pouvaient être réalisées en vrai, en 3D. J’ai fait ça assez tôt, autour de 63 à 67.
LR: Vous étiez sûrement présent à l’ouverture ?
JH: J’étais à l’ouverture du Pavillon canadien, ouais. Mais ce n’est pas comme si je faisais le thème de tout le tralala. Le Pavillon canadien a eu un succès modéré.
LR: Il me semble que c’était l’un des seuls pavillons qui a été conservé quand ils ont continué sous le nom Man And His World…
JH: Ouais. L’une des choses que j’avais à faire était de rédiger les très courtes, petites biographies des gens qui figuraient dans le Katimavik, vous savez—la pyramide à l’envers, et il y avait ces petites armoires avec des gens comme Norman Bethune, Norman McLaren… des gens intéressants. Pendant que j’étais là, j’ai rencontré quelqu’un qui s’appelait David Newman, il était parmi les premiers experts en informatique, embauché pour s’occuper de l’informatique, ou ce qui y ressemblait dans le pavillon. Le but étant de comprendre comment utiliser l’ordinateur dans les expositions et prendre conscience des développements imminents dans le monde informatique.
LR: Alors rendu là, aviez-vous déménagé à Montréal ?
JH: J’ai déménagé en 67 dans un appartement avec Dave Newman et j’ai passé quelques années au sein d’une firme-conseil à faire de la communication et de la futurologie… à trouver des institutions et compagnies et à leur montrer comment les ordinateurs et la communication à l’interne se développaient, à leur faire prendre conscience des choses qui étaient sur le point de voir le jour. C’est très ironique, parce que je n’utilise même pas d’ordinateur aujourd’hui (rires).
LR: Si je me fie à ce que je lis aujourd’hui, je ne sais pas à quel point votre futurologie était correcte, mais il semble que l’opinion générale était qu’il n’y aurait pas d’ordinateurs personnels comme ceux-ci partout, mais plutôt un gros ordinateur auquel les gens pourraient se connecter avec un terminal de données.
JH: Ouais, pour puiser dedans… comme nous avons maintenant le « cloud ».
LR: Vous rappelez-vous si vous aviez correctement prédit certaines choses telles que l’invention de la souris ou du moniteur et de l’interface clavier, par exemple ?
JH: Pour être honnête, je ne m’en souviens pas. On a rencontré [MARSHALL] McLuhan quelques fois.
LR: Il devait être au sommet de sa célébrité.
JH: Il était, ouais… à des conférences et tout. Il surnommait ses conférences : La théorie de la classe de loisir (The leisure of the theory class) ! (rires)
LR: Pour revenir à Expo, je dois vous demander si vous avez pu y voir beaucoup d’artistes performer ?
JH: Je n’en ai pas vu autant que j’aurais pû, parce que ma femme était enceinte et a donné naissance en janvier 1968. Alors on ne pouvait pas aller voir tant de choses, mais ce que je préférais, c’était aller au Pavillon américain et d’écouter les pianistes qui y jouaient tout l’été… Sunnyland Slim était l’un d’eux. Ils n’avaient pas tant de jazz en tant que tel, mais il y avait un genre de petit parcours à travers l’histoire sociale américaine. Les gens s’asseyaient là et jouaient, et c’était essentiellement ça.
LR: Vous rappelez-vous des autres pianistes ? Je suppose que Cecil Taylor n’était pas là ?
JH: Bien, je me le suis souvent demandé, si Cecil a joué là-bas ou non. Je ne pense pas, je n’étais pas très informé en ce qui concernait le jazz libre à cette époque-là, et je suis un peu triste d’avoir été absent quand c’était en train d’être inventé. J’étais là mais je n’en étais pas conscient.
LR: Ce que vous avez dans cette publication (Da Vinci) est une pièce d’art visuel assez abstraite. Quand avez-vous parti ça ?
JH: Bien, ça c’était quand je travaillais sur Expo. Je trouvais que je réfléchissais de plus en plus visuellement, parce que je traduisais les pensées de certaines personnes non pas sous forme d’images à proprement parler, mais de situations qui communiquent ce genre de choses dans l’exposition. J’ai oublié de mentionner plus tôt mon travail au Musée national et plusieurs emplois où je faisais de la kinésiologie, des dioramas ; je veux dire les fabriquer physiquement. Il y avait un gars là-bas qui s’appelait André Steimann, c’était un très bon peintre, un gars néerlandais, et on traînait ensemble et nous étions de très bons amis. J’étais assis avec lui un jour dans une taverne après le travail, et j’ai comme murmuré, littéralement dans son oreille : « Je pense que dans ma prochaine vie, j’aimerais essayer de peindre. » Il me regarda, et dit : « Finis ta bière ! » Alors je finis ma bière et il dit : « Viens avec moi » et il m’emmena—presque par le bout du nez—à son atelier, il m’a donné du matériel et m’a dit : « Vas-y ! » Et c’est ce qui m’a poussé à faire le saut ! Cette première toile existe et se trouve dans la collection du Musée du Québec.
LR: Vraiment—votre première toile ? Comment c’est arrivé ?
JH: Bien, j’avais été sélectionné pour… ils avaient acheté un certain nombre de mes œuvres et j’avais aussi fait don d’un certain nombre de mes œuvres, je pense que j’ai 130-140 de mes œuvres dans une sorte de centre d’archives d’étude au Québec. Et il existe une vraie archive de documents papier que j’ai conservé.
LR: Peignez-vous toujours ?
JH: Oui.
LR: Quel est votre medium préféré ?
JH: Récemment, je me trouve à faire de la sculpture. Je réfléchis à les faire faire fabriquer.
LR: Je suppose que c’est la peinture qui vous a amenée à explorer le—autrefois nouveau—réseau des centres d’artistes autogérés ?
JH: Absolument, ouais. J’ai sauté à pieds joints dans l’abstraction. Bien sûr, j’avais déjà fait pas mal de dessin figuratif d’une manière ou d’une autre, mais pas comme une base pour aller ailleurs, juste comme une manière de penser dans un autre mode. À cette époque, l’abstraction était assez facile à faire exposer, et ça l’est encore aujourd’hui, d’une certaine façon.
LR: Quel était votre opinion sur—puisque vous étiez là depuis le début—la scène galeriste qui n’incluait pas nécessairement des artistes jeunes qui expérimentaient. Je suppose que le long de la rue Sherbrooke les marchands d’art ne s’intéressaient pas beaucoup au nouvel art ou à l’art expérimental…
JH: Il y avait une mouvance féministe sous-jacente au sein des centres d’artistes autogérés—les femmes étaient plutôt absentes de la scène institutionnelle. Assez ironiquement, certains des meilleurs artistes canadiens se trouvaient être des femmes. J’ai commencé à peindre aux alentours de 68, et autour de 70 – 71 il y avait une petite communauté qui se tissait autour de Véhicule.
LR: En 66, le seul qui avait déjà commencé, je crois, était Studio Graff.
JH: Studio Graff, oui, c’était une coopérative. Dans ce temps-là, je pensais à exposer. En 69, je crois, ou début 70, j’ai présenté une exposition à la Galerie Agnès Le Fort, qui était l’une des galeries de la rue Sherbrooke. C’était une très bonne galerie. Ce n’était pas une exposition solo à grande échelle, mais j’avais un mur ou deux là. Voilà pour mes débuts.
LR: Quel était le medium de vos œuvres à ce moment-là ?
JH: C’était de la peinture aérosol. De la peinture aérosol argent et noire, dans un esprit paysager. Je travaillais des formats horizontaux.
LR: Est-ce que la peinture aérosol était quelque chose qu’on achetait à la quincaillerie à l’époque ?
JH: Oui, exactement. J’ai abandonné ça après un bout de temps—Ce n’est pas très bon pour la santé !
LR: Vous n’êtes jamais allé faire du graffiti ou des trucs comme ça ?
JH: Non ! (rires)
LR: Ça devait être pas trop longtemps après votre première exposition quand vous avez décidé de rejoindre l’un de ces centres d’artistes autogérés ? Quand avez-vous entendu parler de Véhicule pour la première fois ? Est-ce que c’était les premiers dont vous avez entendu parler ?
JH: Bien, Véhicule, j’étais en quelque sorte dans les parages lorsqu’ils discutaient de monter la place. Ils en parlaient depuis un certain temps, et j’avais été invité à quelques-unes de ces rencontres. Il y avait un groupe de 13, je pense, l’équipe originale. À ce moment-là, ils élargissaient le groupe, et j’ai trouvé que l’idée était intéressante, et les artistes étaient des gens qui faisaient, ou qui avaient pris conscience de l’art. Il me semblait que c’était un moyen très valide de faire sortir l’art des ateliers et de le faire entrer dans le vrai monde.
LR: Je suppose qu’il y a aussi l’aspect d’avoir un ensemble de collègues avec lesquels tu étais si proche que tu pouvais…
JH: D’une certaine manière, nous étions comme une association de clubs—pas nécessairement un club unique—juste un regroupement d’artistes qui se retrouvaient simplement pour discuter. Ceci devint un peu plus formalisé, en passant des mots à l’action, et de l’espace à la manifestation de l’action.
LR: Vous rappelez-vous de Guy Lavoie ? Était-il l’un des premiers à faire partie de ce groupe ?
JH: Oui, lui et Sy Dardick en entendirent parler et il dit : « Pourrions-nous, par tous les hasards, démarrer une presse ? » et les gens ont dit : « Ouais, bien, ça c’est un autre medium. » Ils n’étaient pas réellement membres à part entière de Véhicule, mais je pense qu’ils avaient leur mot à dire pour ce qui était de son fonctionnement.
LR: C’est certainement l’une des choses qui les distinguaient des autres, la présence de cette presse—une vraie ressource à avoir dans les locaux quelle que soit la raison—pas seulement pour des livres, mais aussi pour l’art imprimé, pour faire des éditions de multiples…
JH: Oui, et ils étaient aussi—dans un sens—un imprimeur commercial.
LR: L’espace n’était pas seulement le local des membres…
JH: Il y avait beaucoup de musique, beaucoup de concerts étant initiés sur l’invitation de Véhicule. Je me souviens être allé à un concert de Dave Turner, qui jouait beaucoup là. Mais ils faisaient aussi venir du monde comme le saxophoniste de Philip Glass, Dickie Landry, qui a fait quelques concerts là-bas. Bill Viola est venu et y a donné un concert avant qu’il ne devienne connu.
LR: Gardez-vous contact avec des gens de cette époque ?
JH: Bien, je vois Sy Dardick à l’occasion. Il y a des gens comme Suzy Lake, que je n’ai pas vu depuis un bout de temps, mais on pourrait garder des liens. Quelques-uns des membres sont décédés.
LR: Vous souvenez-vous quand ceci (ses pages dans le magazine Da Vinci – ADD LINK to MUO Image Blog page) est sorti ? Ça semble être de l’impression manuelle avec des notes.
JH: Des impressions manuelles avec du script, mais le script ne dit pas nécessairement grand chose… juste un semblant de langage, une sorte de paysage mental.
LR: Vous souvenez-vous comment ceci a pris forme ? Ont-il dit : « Voudriez-vous faire quelque chose, on a un autre numéro qui va sortir… »
JH: Ouais, c’était comme ça, par bouche à oreille. On faisait des lectures à Véhicule… les gens traînaient là, ce n’était pas un clubhouse, mais c’était un bel espace dans lequel se trouver. Ils demandaient aux gens de contribuer, au lieu d’attendre qu’ils viennent assister aux événements.
LR: Je présume que personne ne se faisait promettre de cachet ou que personne ne s’attendait à en recevoir ?
JH: Rien du tout.
LR: Alors vous leur remettiez simplement les feuillets originaux, je suppose ? Et vous rappelez-vous s’il y a eu un party de lancement lorsque c’est sorti ?
JH: C’est très possible.
LR: Je suppose que vous vous attendiez à recevoir 1 ou 2 copies et c’est tout. C’était ça votre récompense…
JH: Ouais, exact. C’est une vieille, vieille tradition propre aux magazines littéraires.
LR: Nous avons beaucoup de magazines, fanzines et périodiques dans nos archives mais je n’ai jamais vu quelque chose de semblable au vôtre. Vous souvenez-vous avoir été publié ailleurs ?
JH: J’étais dans le premier numéro de Parachute, c’est assez rare mais je pense que vous pourriez le trouver à la bibliothèque. Je pense que le premier numéro est sorti autour de 1975. N’essayez pas de l’acheter cependant—c’est assez recherché ! (rires) J’avais une exposition au Musée d’art contemporain en 1976, et il y en a eu un catalogue.
LR: Grâce à tous les gens avec qui l’on conduit des entrevues (dans le cadre du projet Montreal Underground Origins), j’essaie de me faire une meilleure idée de l’atmosphère de l’époque surtout, du Montréal du début des années 70. C’était un peu différent comme époque, plus modeste. Il me semble, après avoir fait des recherches là-dessus, que c’était un peu plus intime, confiné, particulièrement du côté anglophone de la ville.
JH: Véhicule était en contact avec les artistes du Québec… mais c’était majoritairement anglophone. Il y avait des contacts sporadiques, vous savez, de l’amitié.
LR: Qu’en est-il des autres centres comme Le Conventum, la salle de concert et le centre d’artistes ? Vous rappelez-vous d’y avoir été ?
JH: Je n’y suis jamais allé, non, mais je m’en rappelle… sur Sanguinet. Je n’allais pas beaucoup aux concerts de musique.
LR: Avez-vous vu le Quatuor de Jazz-Libre du Québec à cette époque ?
JH: L’enregistrement que j’ai fait avec Yves Bouliane, qui était leur contrebassiste, c’était en 87 environ, je n’ai commencé à jouer qu’en 84, re-jouer ! Ça c’était une connexion.
LR: En 1975, vous viviez à proximité de Véhicule, n’est-ce pas ?
JH: Je n’étais pas trop loin de là, parce que j’ai divorcé cette année-là et j’habitais en haut de la rue Sherbrooke, et j’ai déménagé en bas de la rue Clark près de Maisonneuve. Il y avait un bâtiment là-bas—c’est aujourd’hui détruit—un très beau bâtiment, 8000 pieds carrés, et le loyer était de 185 $ par mois. C’était un bel espace.
LR: Vous rendiez-vous à quelques-uns des cafés à proximité comme Prag ou the New Penelope ?
JH: Je suis allé au New Penelope quelques fois pour écouter les blues bands, Muddy Waters. J’ai vu Howlin’ Wolf au The Esquire, là où se trouve aujourd’hui Chez Parée.
LR: The Swiss Hut se trouvait à côté du Penelope…
JH: The Swiss Hut était un bar où les Québécois… et il y avait ce bar sur St-Denis où allaient les artistes Québécois. Il y avait un sentiment de connexion avec les artistes québécois, il n’y avait pas de concurrence à l’époque. Enfin, il y avait quand même des appartenances politiques fortes…
LR: Je suppose qu’entre St-Denis et St-Laurent, il y avait cette zone…
JH: L’un des théâtres là-bas a fait venir pendant un certain temps des gens comme [THELONIOUS] Monk et ainsi de suite.
LR: Y a-t’il eu d’autres concerts mémorables au Esquire ?
JH: Rahsaan Roland Kirk.
LR: Faisiez-vous formellement partie du collectif Véhicule ?
JH: J’en étais membre, oui. Cependant je ne me souviens pas s’il fallait cotiser pour devenir membre.
LR: Vous êtes passé à un autre centre d’artistes autogéré à un moment donné, non ?
JH: J’étais impliqué auprès d’Optica pendant quelques années. C’était plutôt une galerie photographique, mais je voulais passer à une galerie plus générale. À cette époque, c’était dans le théâtre Centaur.
LR: Est-ce que vous traîniez à certains endroits dans le Vieux-Montréal comme à l’Hôtel Nelson ?
JH: Peut-être à quelques reprises. Il y avait le Black Bottom sur St-Paul, et il y avait aussi un autre lieu sur une rue latérale près de St-Laurent, beaucoup de monde se retrouvait là… Sonny Rollins jouait là.
LR: Gagniez-vous votre vie uniquement en peignant ? Deviez-vous continuer à avoir des emplois étranges ?
JH: Des emplois « de travail », ouais. J’étais dans une firme-conseil pendant un certain temps, et puis j’ai commencé à investir un peu. Avec la peinture, je dirais que la pratique se supportait elle-même. C’était un revenu utile. J’en vendais un certain nombre chaque année.
LR: Vous n’aviez pas d’agent ou de représentant de galerie à cette époque ?
JH: Tout à fait, j’en avais un. J’ai une galerie qui me représente encore, Roger Bellemare, mais il a pris une pause à la fin des années 80-début des années 90 et a rouvert à nouveau au début de ce siècle.
LR: Mais il vous représentait dans les années 1970 ?
JH: Ouais. Je le connais depuis longtemps—très fidèle—il est gentil, il est très encourageant.