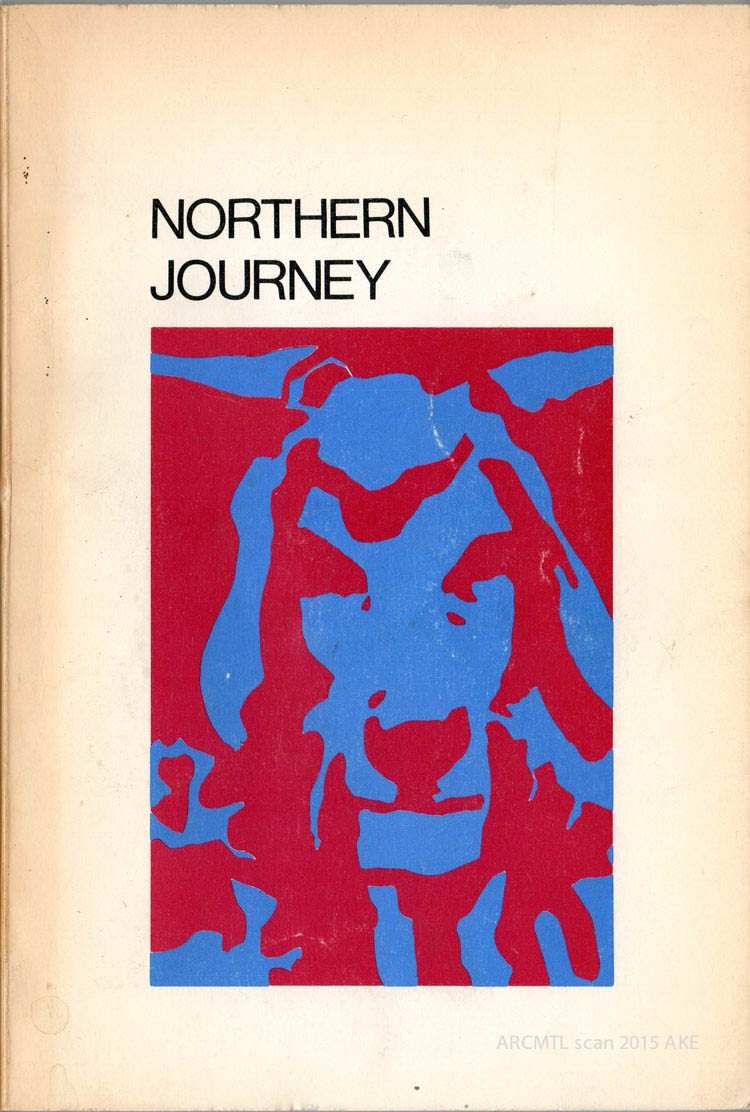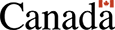Les débuts de la presse alternative à Montréal, années 1970
Lors de l’énorme salon des petits éditeurs Expozine, le dimanche 16 novembre 2014, Archive Montréal a tenu une table ronde au sujet du milieu de la presse indépendante des années 1970 à Montréal.
Les participants étaient les fondateurs de Véhicule Press, Simon Dardick et Nancy Marrelli, et le propriétaire de la librairie montréalaise The Word, Adrian King-Edwards. La discussion était modéré par Louis Rastelli.
À partir du milieu des années 1960, les quartiers centraux de Montréal ont commencé à développer un nouveau milieu culturel au sein duquel les artistes, les écrivains, les poètes et les musiciens pouvaient développer leurs pratiques artistiques innovatrices en collectivité. Ils ont développé des réseaux et des lieux de diffusions indépendants de ce qui était la norme de l’époque. Ces nouveaux espaces culturels ainsi que l’infrastructure de ces centres d’artistes autogérés, ces stations de radio communautaires, ces publications et presses indépendantes ont été incubateurs d’un mouvement « underground » de l’art dans plusieurs disciplines et qui, ne cesse de se perpétuer jusqu’à aujourd’hui.
Dans ce milieu embryonnaire de la contreculture, les Montréalais pouvaient assister à des lectures à la librairie The Word ou au centre d’artistes auto-géré Véhicule Art. La démocratisation des modes de production qui a marqué le début des années 70 – par exemple l’accès aux laboratoires de photographie, à la vidéo, aux presses collectives et divers centres d’artistes et centres communautaire – a également aidé à démocratiser et étendre la pratique artistique indépendante du « do it yourself », une tendance qui continue à s’accélérer encore de nos jours.
LÉGENDE
LR = Louis Rastelli
SD = Simon Dardick
NM = Nancy Marrelli
AKE = Adrian King-Edwards
LR : À quand remonte votre premier contact avec le milieu des petits éditeurs indépendants de Montréal ?
SD : Je suis un réfugié de Kingston, Ontario. Je suis venu ici dans les années 60, mais avant de venir ici, j’avais l’habitude de lire tous les magazines littéraires et les livres publiés à Montréal. J’avais l’habitude de lire les livres de Louis Dudek, Ray Souster, et les livres qu’ils publiaient sous les Éditions Contact. Donc, avant de venir ici, j’étais déjà préparé et puis Toronto ne m’attirait pas. Je ne veux pas dénigrer Toronto ; la ville n’avait tout simplement pas le même attrait littéraire que Montréal. Alors, quand je suis arrivé ici, tu flânes un peu, tu vois ? On traînait au Swiss Hut sur la rue Sherbrooke, non loin du club New Penelope. Au Swiss Hut, il y avait un mélange incroyable de gens : vous aviez des gens politisés, des felquistes, des syndicalistes, des littéraires, bref c’était un endroit génial. C’est à ce moment que j’ai commencé à avoir une idée du milieu.
AKE : Moi aussi je suis venu de l’Ontario et je suis allé à l’Université McGill. J’ai commencé à McGill en 67 et j’ai étudié la littérature anglaise. Et comme la plupart des étudiants en littérature anglaise, je voulais devenir poète, écrivain. J’ai suivi des cours en création littéraire et suite à l’obtention de mon diplôme, j’ai voyagé à travers l’Europe. Je suis revenu à l’âge de 21 ou 22 ans et j’ai estimé qu’il était temps d’écrire mes mémoires (rires). J’ai trouvé un minuscule appartement sur Lorne au sous-sol qui avait : une plaque chauffante dans le couloir, un matelas au sol, un bureau et une machine à écrire. J’ai pensé que j’avais tout ce dont j’avais besoin. L’appartement me coûtait 8 $ par semaine, donc les frais étaient vraiment bas. J’avais sagement renoncé à la poésie ; je me concentrais sur mes mémoires.
Ensuite, j’ai été distrait ; j’ai rencontré ma femme, nous sommes partis en Colombie-Britannique et nous avons passé l’été à vendre des livres à partir de notre fourgonnette Volkswagen. On ne pouvait pas faire la vente dans les zones municipales, mais on pouvait le faire dans des endroits comme des campements pour caravanes, pour miniers, bûcherons et autres. On a donc voyagé à travers la Colombie-Britannique en vendant des livres. C’était encore une ambition littéraire, mais un peu détournée.
Je suis revenu à Montréal et je voulais ouvrir une librairie. J’ai pensé que ce serait une chose vraiment amusante à faire et j’ai trouvé un 4 et demi sur la rue Milton pour 100 $ par mois, juste à côté de l’endroit où la boutique est aujourd’hui. Je n’ai pas vérifié récemment, mais je crois que ça l’a pas mal augmenté. Toutes les portes le long de la rue Milton étaient les mêmes et puisque nous avions tous deux étudié au département de langue anglaise et que nous voulions attiré les étudiants de McGill dans notre boutique de livres d’occasion, nous avons placé une image de George Bernard Shaw sur notre porte pour indiquer là où la librairie cool et underground se trouvait.
Les gens ont commencé à venir ; c’était très populaire et nous nous amusions beaucoup. Nous voulions vraiment connecter avec la communauté de la poésie. C’était en 72 ou 73, exactement quand les choses ont commencé. On était à la bonne place, au bon moment.
Un jour, Fraser Sutherland, alors rédacteur en chef du Northern Journey, est entré. Il avait été envoyé par M. George d’Argo – M. George est certainement l’un de mes mentors – et il voulait savoir si nous voulions avoir le Northern Journey à la boutique. À ce moment, j’ai pensé que nous avions réussi, que nous avions connecté avec la scène littéraire.
Nous sommes partis de là et nous avons organisé des lectures de poésie une fois toutes les deux semaines dans notre appartement, situé juste au-dessus de la librairie. Il y a avait tellement d’allées et venues qu’un après-midi, deux policiers sont venus faire une descente. Ils ont passé au peigne fin toutes les épices de la cuisine. L’un d’eux s’ennuyait tant qu’il s’est allongé sur le sol pour jouer avec nos chatons qui venaient de naître dans notre placard.
Quoi qu’il en soit, ils nous ont laissés tranquilles et ont continué leur chemin. Nous avons fait les lectures pendant environ un an et demi et à ce moment, la communauté littéraire était vraiment petite de sorte que vous pouviez connaître à peu près tout le monde de la communauté littéraire anglophone.
C’était un temps vraiment excitant, tout le monde débutait : Fred Louder, les presses Villeneuve qui commençait à faire des impressions fines, les lectures de Véhicule commençaient, nous y allions les dimanches après-midi à deux heures. J’ai même une affiche des lectures de Véhicule datant de 1975 pour vous donner une idée à quel point ils étaient actifs.
À ce stade, nous étions à la recherche d’un local. Nous étions déchirés entre vraiment chercher un local et attendre qu’il nous trouve. Un jour, je suis sorti pour promener le chien et le bâtiment où The Word Bookstore se trouve aujourd’hui, était une buanderie chinoise qui affichait : à louer.
C’était une évidence, la chose à faire. Nous sommes entrés et les choses étaient beaucoup plus faciles en 1975, le loyer était de 175 $ par mois et nous vendions des livres pour 25 cents. Les livres classés par ordre alphabétique étaient 35 ou 40 cents… c’était une époque plus facile.
Nous avons continué les lectures de poésie et nous avons aussi publié quelques titres. Nous avons publié avec Fred Louder et Brian McCarthy était aussi un poète alors. Brian vivait sur la rue Saint-Laurent juste au-dessus où sont les monuments aujourd’hui et alors qu’il quittait pour l’Europe, j’ai réussi à acheter sa collection de poésie ce qui était spectaculaire pour une librairie qui venait tout juste de commencer. J’ai réussi à obtenir sa machine Gestetner – beaucoup de choses dans les années 70 ont été produites sur une Gestetner – pour publier des trucs d’auteurs.
LR : Juste pour clarifier – un Gestetner est une presse cylindrique à manivelle que vous utiliseriez pour faire des copies de vos textes tapés à la machine à écrire.
NM : Véhicule a commencé en tant que galerie, la première galerie d’artistes autogérés à Montréal et la deuxième galerie d’artistes autogérés au Canada. Powerhouse était la galerie gérée par des femmes et elle était très, très importante en établissant un lieu où les femmes se sentaient en sécurité et à l’aise et où leur travail pouvait être montré.